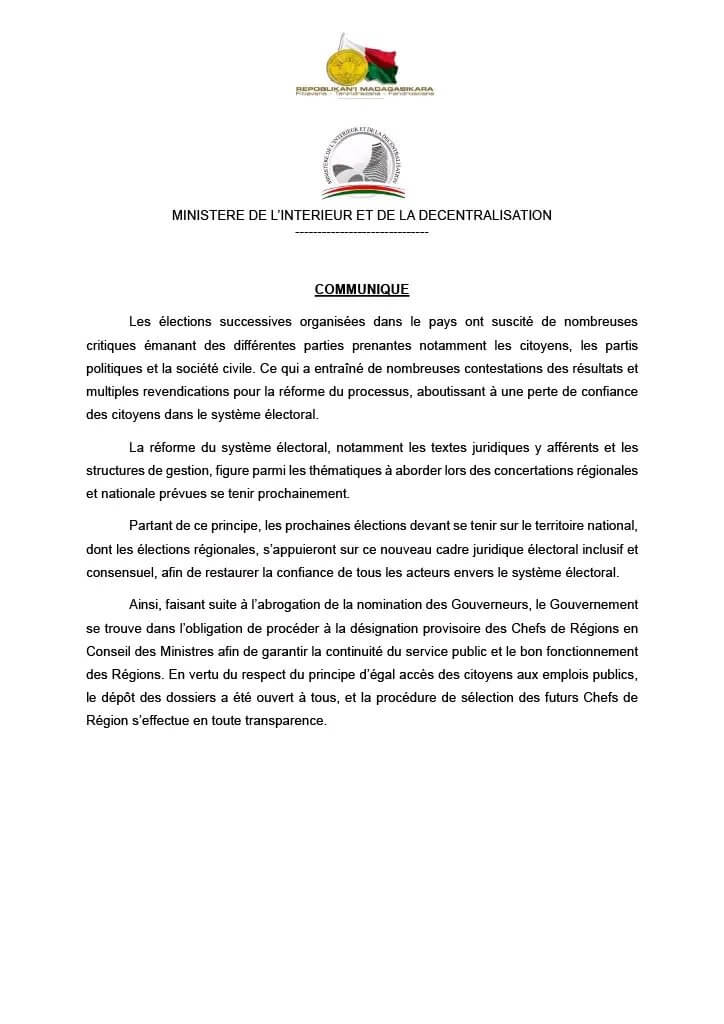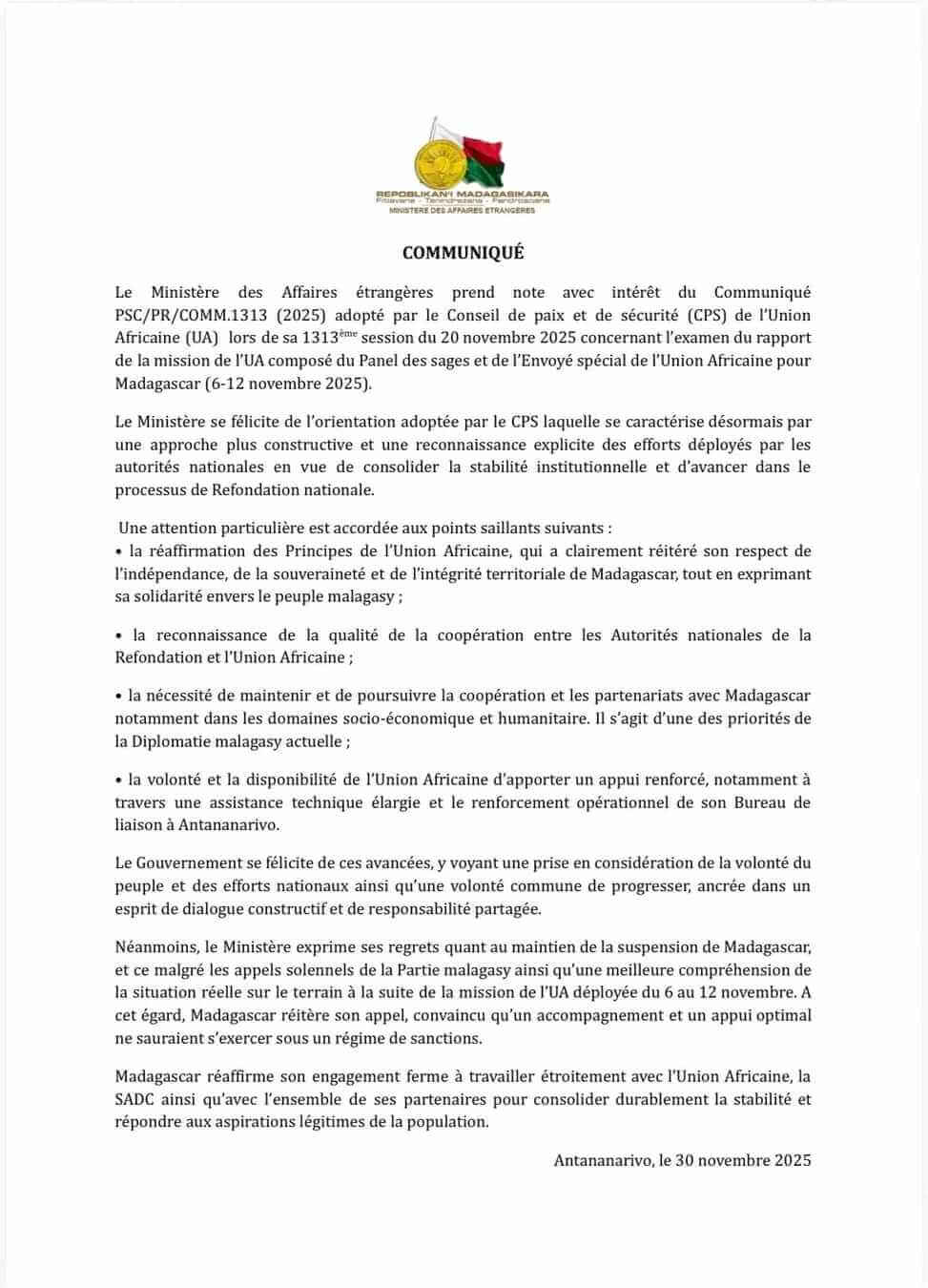L’île de Madagascar, perle de l’océan Indien souvent associée à sa biodiversité exceptionnelle et à la chaleur de ses habitants, s’est transformée ces dernières semaines en un théâtre de tensions et de désespoir. Depuis la fin du mois de septembre 2025, un mouvement social inédit par son ampleur et sa nature secoue Antananarivo, la capitale. À l’origine, la colère populaire contre les coupures incessantes d’eau et d’électricité s’est muée en une contestation politique majeure. Le 9 octobre, des milliers de manifestants ont envahi les rues de la capitale, exprimant leur ras-le-bol d’un système qu’ils jugent corrompu, inefficace et déconnecté des réalités du peuple.
Cette journée, marquée par des affrontements violents, des blessés et des arrestations, symbolise une fracture profonde entre une jeunesse en quête d’avenir et un pouvoir accusé de dérive autoritaire. Au-delà des chiffres et des slogans, c’est une nation entière qui semble se chercher un nouveau souffle.
Une colère populaire née de la précarité quotidienne
À l’origine de ce soulèvement, il n’y a ni parti politique structuré ni leader charismatique. Le mouvement est né spontanément sur les réseaux sociaux, porté par des jeunes issus de la génération dite Gen Z, celle qui a grandi dans un monde globalisé, connecté, et qui refuse de se taire face à l’injustice.
Les coupures d’eau et d’électricité, devenues quasi quotidiennes à Antananarivo et dans d’autres grandes villes, ont été la goutte d’eau de trop. Dans un pays où près de 80 % de la population vit avec moins de 2,80 euros par jour, l’accès aux services de base reste un défi permanent. Ces privations, cumulées à la flambée des prix, à la corruption endémique et au chômage massif, ont ravivé une colère longtemps contenue.
Les manifestants scandent que « le problème, c’est le système ». Derrière ces mots se cache une dénonciation de décennies d’échecs politiques, depuis l’indépendance de la France en 1960. Malgré les promesses successives de réformes, de relance économique et de modernisation, la population constate un fossé grandissant entre les élites et le peuple. Les jeunes, en particulier, se sentent exclus d’un avenir qu’ils jugent confisqué.
Le 9 octobre, cette frustration s’est matérialisée dans les rues d’Antananarivo, où des milliers de citoyens ont bravé les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc pour réclamer un changement profond.
La répression : le choix de la fermeté face à la contestation
Le pouvoir malgache a réagi à la mobilisation par une démonstration de force. Dès la mi-journée, les forces de l’ordre ont dispersé les rassemblements à coups de grenades lacrymogènes et de charges d’engins blindés. Plusieurs observateurs de l’AFP ont rapporté des scènes de chaos : des manifestants érigent des barricades à partir de bacs à ordures, tandis que d’autres ripostent par des jets de pierres.
Les affrontements se sont étendus à plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Anosibe, où un homme a été roué de coups par des agents de sécurité avant d’être évacué par la Croix-Rouge. Des journalistes présents sur place évoquent au moins quatre blessés par balles en caoutchouc, et plusieurs autres victimes de grenades assourdissantes.
Plus choquant encore, des gaz lacrymogènes ont été tirés à proximité d’une maternité, forçant le personnel à déplacer des nouveau-nés prématurés pour éviter qu’ils ne soient asphyxiés. Ces images ont profondément choqué l’opinion publique et renforcé le sentiment d’une dérive répressive incontrôlée.
Le gouvernement, de son côté, justifie cette fermeté au nom du maintien de l’ordre public. Le président Andry Rajoelina, accusé de s’accrocher au pouvoir, affirme que les violences proviennent de « casseurs » infiltrés dans les cortèges. Il dénonce ce qu’il qualifie de tentative de déstabilisation orchestrée par des opposants et des acteurs étrangers.
Mais pour de nombreux Malgaches, cette justification ne passe plus. L’usage disproportionné de la force alimente la colère et radicalise davantage la population, notamment la jeunesse, qui voit dans cette répression la preuve que le pouvoir refuse d’écouter ses citoyens.
Une crise politique aux racines profondes
La situation actuelle est loin d’être un simple épisode de mécontentement social. Elle s’inscrit dans un contexte politique fragile, où la confiance entre le peuple et les institutions est profondément érodée.
Andry Rajoelina n’en est pas à sa première confrontation avec la rue. Déjà en 2009, il avait accédé au pouvoir à la faveur d’un mouvement populaire soutenu par l’armée, renversant alors Marc Ravalomanana. Depuis, malgré plusieurs alternances et promesses de renouveau, les espoirs d’un véritable changement démocratique se sont dissipés.
Réélu en 2023 lors d’un scrutin marqué par le boycott de l’opposition, le président tente aujourd’hui de reprendre la main. Le renvoi de son gouvernement et la nomination du général Ruphin Zafisambo au poste de Premier ministre, début octobre, traduisent une volonté d’affermir son contrôle. Mais cette décision est perçue comme une militarisation du pouvoir plutôt que comme une ouverture politique.
La société civile, par la voix de plus de 200 organisations, dénonce une « dérive militaire » inquiétante. Pour ces acteurs, confier les postes clés de la Sécurité publique, des Armées et de la Gendarmerie à des figures militaires renforce le risque d’un glissement autoritaire.
Le souvenir des crises passées, souvent soldées par des violences et des transitions incertaines, plane toujours sur la Grande Île. Le spectre d’une nouvelle instabilité politique inquiète la communauté internationale, alors que le pays peine à se relever des conséquences économiques de la pandémie et des cyclones successifs.
La jeunesse malgache, moteur du changement
Au cœur de cette contestation, une génération se distingue par sa détermination et sa créativité : celle des jeunes urbains, connectés, formés mais souvent sans perspectives. Le mouvement « Gen Z Madagascar » n’a ni structure hiérarchique claire ni leader autoproclamé. Il s’appuie sur les réseaux sociaux, sur des appels à la désobéissance civile et sur des slogans fédérateurs.
Cette jeunesse exprime un profond sentiment d’injustice et de désillusion. Nombreux sont ceux qui affirment ne plus croire aux institutions. Pour eux, la politique traditionnelle est synonyme de corruption, de mensonges et d’immobilisme. Les manifestations du 9 octobre ne sont pas seulement une réaction aux coupures d’eau et d’électricité, mais aussi une révolte contre un système qui ne leur laisse aucune place.
Les témoignages recueillis sur place traduisent cette exaspération. Heritiana Rafanomezantsoa, 35 ans, confie : « Depuis l’indépendance, notre vie ne s’est pas améliorée. On vit toujours dans la galère. » De son côté, Niaina Ramangason, étudiant à l’École polytechnique d’Antananarivo, déclare : « Le président fait des promesses mais ne les réalise jamais. Je n’y crois plus. »
Pour de nombreux observateurs, ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large observée ailleurs en Afrique : celle d’une jeunesse qui revendique sa place dans la vie publique et qui n’accepte plus d’être spectatrice de son destin.
Mais cette génération, malgré sa force numérique et sa capacité de mobilisation, se heurte à un appareil d’État verrouillé et à une répression systématique. Plusieurs dizaines de manifestants ont déjà été arrêtés, certains placés en détention provisoire, d’autres sous contrôle judiciaire. Les avocats bénévoles qui les défendent dénoncent des procédures expéditives et des violations des droits fondamentaux.
Un pays à la croisée des chemins
La crise actuelle pose une question fondamentale : quel avenir pour Madagascar ?D’un côté, le gouvernement tente de reprendre le contrôle par la force, misant sur une stratégie de fermeté et sur le soutien des forces armées. De l’autre, la rue continue de se mobiliser, malgré la peur et la fatigue.
Les appels à la grève générale lancés par le mouvement Gen Z peinent encore à être suivis massivement, mais le malaise social est palpable. Dans plusieurs établissements scolaires et administrations, des débrayages ont été constatés. La pénurie d’eau et d’électricité persiste, aggravant la détresse des populations les plus pauvres.
Sur le plan international, les partenaires de Madagascar observent la situation avec inquiétude. L’ONU a évoqué un bilan d’au moins 22 morts depuis le début des manifestations, un chiffre contesté par le président, qui parle de « douze pilleurs ». Quoi qu’il en soit, ces pertes humaines témoignent de la gravité du moment.
L’avenir immédiat dépendra de la capacité du pouvoir à ouvrir un dialogue réel avec la société civile et à répondre aux aspirations profondes d’une population épuisée. Si la dérive autoritaire se confirme, le risque d’un embrasement plus large n’est pas à exclure.
Mais au-delà des affrontements, un espoir demeure : celui d’une prise de conscience collective. Les Malgaches, et particulièrement les jeunes, semblent décidés à ne plus subir. Ils réclament une gouvernance transparente, des services publics dignes de ce nom, et surtout, la reconnaissance de leur dignité.
Conclusion : le souffle d’une nation en quête de justice
Le 9 octobre 2025 restera sans doute comme une date charnière dans l’histoire contemporaine de Madagascar. Ce jour-là, la colère a éclaté, non pas comme un feu de paille, mais comme l’expression d’un malaise profond et durable.
Les rues d’Antananarivo, envahies par des manifestants réclamant le respect, la justice et un avenir meilleur, ont révélé une vérité crue : le pays ne peut plus continuer ainsi. L’économie vacille, la pauvreté progresse, la jeunesse s’exile ou se révolte, et les institutions peinent à incarner l’espoir.
Face à cette crise, deux chemins s’offrent à Madagascar : celui de la répression et de la peur, ou celui du dialogue et de la reconstruction. Si le premier conduit inévitablement à de nouvelles fractures, le second pourrait marquer la renaissance d’une démocratie véritable, portée par un peuple qui refuse d’abandonner.
Madagascar, terre de contrastes et de résilience, a souvent su se relever des tempêtes. La mobilisation actuelle, malgré ses drames, témoigne d’une volonté de transformation. Peut-être est-ce là le signe qu’un nouveau chapitre s’ouvre, écrit non plus par les puissants, mais par la voix du peuple lui-même.