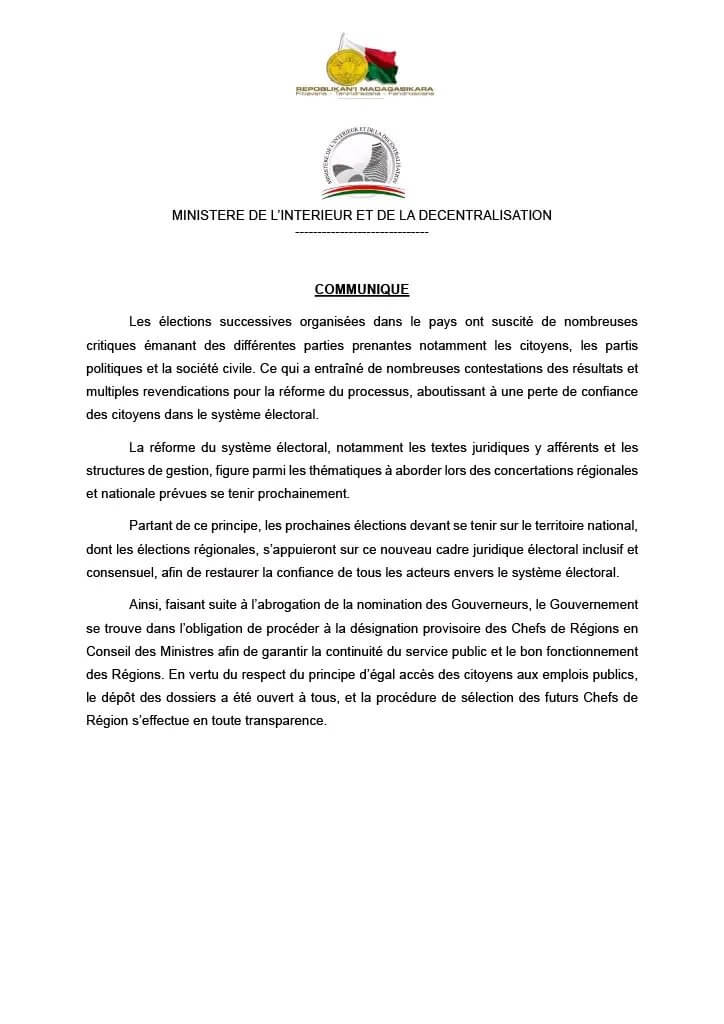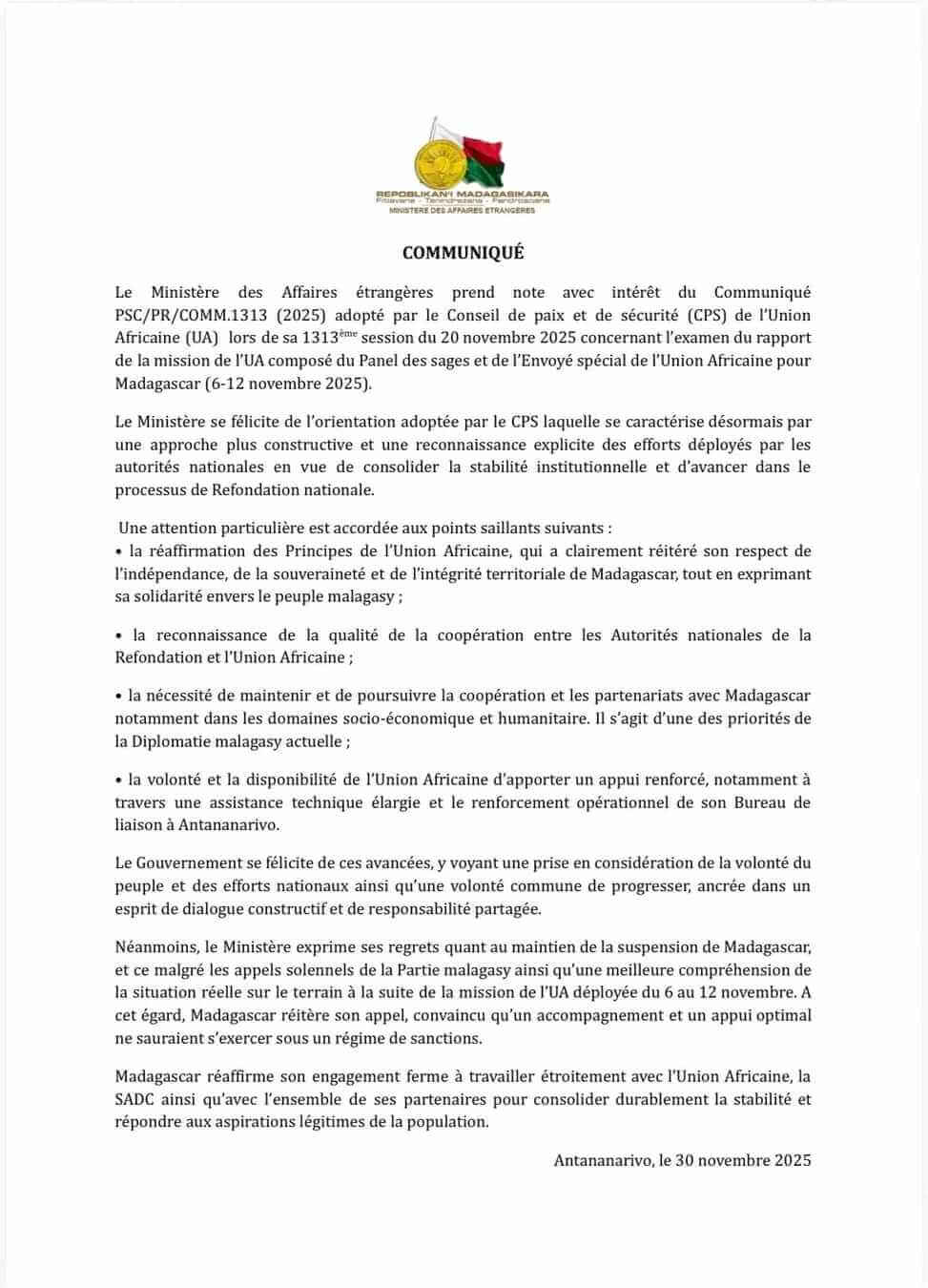Dans un contexte de crise politique croissante, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a pris une décision d’une portée institutionnelle majeure : la dissolution de l’Assemblée nationale. Le décret n°2025-1051, daté du 14 octobre 2025 et signé à Antananarivo, officialise cette mesure exceptionnelle, fondée sur l’article 60 de la Constitution malgache. Ce geste, lourd de conséquences politiques, institutionnelles et sociales, intervient alors que le pays traverse une période de fortes tensions entre les différentes branches du pouvoir.
Le texte présidentiel, publié par la Présidence de la République, invoque les dispositions constitutionnelles et légales pour justifier cette décision immédiate, qui prend effet dès sa diffusion radiotélévisée, avant même son insertion au Journal officiel. Cette dissolution ouvre une nouvelle phase d’incertitude politique à Madagascar, marquée par la perspective d’élections législatives anticipées et par la reconfiguration du paysage politique national.
Une décision prise en vertu de la Constitution
Selon le décret signé par le président Andry Rajoelina, la dissolution de l’Assemblée nationale s’appuie sur l’article 60 de la Constitution malgache, qui confère au chef de l’État le pouvoir de mettre fin au mandat de cette institution sous certaines conditions précises. Le texte stipule que cette décision a été prise après consultation du Premier ministre et des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux exigences légales.
L’article premier du décret est sans ambiguïté : « Conformément aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, l’Assemblée nationale est dissoute. » Cette formule lapidaire traduit la solennité et la gravité de la mesure. Elle marque une rupture nette dans le fonctionnement institutionnel du pays, suspendant le mandat des députés et plaçant le pouvoir législatif dans une période transitoire jusqu’à la tenue de nouvelles élections.
Le président s’est appuyé également sur l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé. Celle-ci permet au chef de l’État, en cas d’urgence, de donner effet immédiat à un décret dès sa diffusion radiophonique ou télévisée. Ce recours exceptionnel montre la volonté du président d’agir sans délai, justifiant une urgence institutionnelle face à la situation politique actuelle.
La dissolution de l’Assemblée nationale représente l’un des instruments constitutionnels les plus forts dont dispose le président de la République. Utilisée rarement, cette mesure traduit généralement une impasse politique majeure entre l’exécutif et le législatif, ou une crise nationale nécessitant un retour aux urnes.
Un acte présidentiel dans un contexte de crise politique
La décision de dissoudre l’Assemblée nationale intervient dans un climat politique particulièrement tendu. Depuis plusieurs semaines, la scène nationale est marquée par des affrontements institutionnels, des divisions au sein des partis politiques et une montée de la contestation populaire. Plusieurs observateurs évoquent une crise de confiance entre le pouvoir exécutif et le Parlement, exacerbée par des désaccords sur la gouvernance et la gestion des affaires publiques.
Des tensions avaient émergé autour de projets de loi controversés, de motions parlementaires et de divergences sur les priorités économiques et sociales du gouvernement. L’opposition parlementaire avait accusé l’exécutif d’entraver le fonctionnement démocratique, tandis que le gouvernement reprochait à certains députés de bloquer les réformes jugées indispensables à la stabilité du pays.
Dans ce contexte, la dissolution apparaît pour certains comme une tentative de rétablir l’ordre institutionnel, mais pour d’autres, elle symbolise un durcissement du pouvoir présidentiel. Ce geste, bien que conforme à la Constitution, est interprété différemment selon les acteurs politiques. Pour le camp présidentiel, il s’agit d’un acte nécessaire pour restaurer la cohérence politique et mettre fin à une paralysie institutionnelle. Pour l’opposition, en revanche, cette mesure traduit une dérive autoritaire et une volonté de contrôle total du pouvoir.
Cette dissolution intervient également alors que Madagascar traverse une période d’incertitude économique et sociale. Les tensions politiques ont contribué à fragiliser les institutions et à ralentir la mise en œuvre des politiques publiques. La perspective d’élections anticipées, dans un tel climat, pourrait redessiner les équilibres politiques du pays tout en testant la capacité des institutions à organiser un scrutin crédible et transparent.
Les conséquences institutionnelles et politiques immédiates
La dissolution de l’Assemblée nationale entraîne des conséquences immédiates sur le fonctionnement du système politique malgache. En premier lieu, les mandats des députés sont suspendus, mettant fin à leurs activités parlementaires. Le pays entre ainsi dans une phase transitoire où le pouvoir législatif ne pourra plus exercer pleinement ses prérogatives, notamment en matière de vote des lois et de contrôle de l’action gouvernementale.
Le gouvernement, pour sa part, demeure en place mais sous un régime d’affaires courantes, limité dans ses initiatives législatives majeures. La Constitution prévoit qu’à la suite d’une dissolution, de nouvelles élections législatives doivent être convoquées dans un délai fixé par les textes réglementaires, généralement dans les 60 jours. Ce calendrier électoral devra être précisé par décret, en coordination avec la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Sur le plan politique, cette dissolution redistribue les cartes. Les partis vont devoir se repositionner rapidement pour préparer la prochaine bataille électorale. Les formations proches du pouvoir tenteront de consolider leur majorité en capitalisant sur le leadership présidentiel, tandis que l’opposition cherchera à fédérer ses forces pour proposer une alternative crédible.
Cette période pourrait également accentuer les recompositions politiques, avec la création de nouvelles alliances ou de scissions au sein des blocs existants. Certains députés indépendants ou figures influentes pourraient tenter de rallier de nouveaux courants pour peser sur les négociations à venir.
D’un point de vue institutionnel, la dissolution soulève aussi la question de la stabilité démocratique. Elle remet en cause, au moins temporairement, l’équilibre des pouvoirs et place la présidence au centre de la vie politique. Si elle est perçue comme un moyen de restaurer la légitimité du pouvoir législatif, elle peut aussi être interprétée comme une recentralisation du pouvoir exécutif au détriment du pluralisme parlementaire.
Une lecture politique et symbolique du décret présidentiel
Au-delà de sa portée juridique, le décret n°2025-1051 porte une charge symbolique forte. En dissolvant l’Assemblée nationale, le président Andry Rajoelina envoie un message clair : celui d’une reprise en main du processus politique et d’une volonté de réaffirmer l’autorité de l’État.
Le choix du moment, en pleine crise politique, ne doit rien au hasard. Il intervient après plusieurs semaines de débats houleux et de contestations publiques, où la légitimité des institutions était de plus en plus mise en cause. En décidant de trancher, le chef de l’État entend sans doute reprendre l’initiative et tenter de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions républicaines.
Ce décret met également en lumière la centralisation du pouvoir présidentiel dans le système politique malgache. Depuis la mise en place de la IVe République, la Constitution confère au président des prérogatives étendues, notamment en matière de nomination, de dissolution et de sécurité nationale. En recourant à cette disposition, Andry Rajoelina réaffirme le rôle du président comme arbitre suprême de la vie politique.
Sur le plan symbolique, la référence explicite à la Constitution et à la législation de 1962 souligne la légalité de la démarche, mais aussi sa dimension d’urgence nationale. L’expression « en raison de l’urgence » utilisée dans le décret traduit la gravité de la situation et justifie la mise en œuvre immédiate de la décision sans attendre sa publication au Journal officiel.
Cette démarche rappelle également certains précédents historiques dans la vie politique malgache, où des dissolutions ont marqué des tournants décisifs dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le législatif. Chaque fois, ces épisodes ont été suivis de recompositions politiques et d’élections anticipées censées redonner la parole au peuple.
Les réactions et les enjeux pour la stabilité du pays
L’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale a immédiatement suscité une vague de réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Du côté des partisans du président, cette décision est saluée comme une mesure de clarification institutionnelle nécessaire. Selon eux, elle permettra de mettre fin à une période d’instabilité parlementaire et d’ouvrir la voie à un renouvellement démocratique.
L’opposition, en revanche, dénonce une manœuvre politique destinée à consolider le pouvoir présidentiel. Plusieurs de ses représentants estiment que la dissolution vise à neutraliser une Assemblée devenue critique envers l’exécutif et à affaiblir les contre-pouvoirs. Certains responsables politiques appellent déjà à une mobilisation pacifique pour défendre la légitimité des institutions et exiger un calendrier électoral transparent.
Les organisations de la société civile et les observateurs internationaux suivent également la situation de près. Des appels au dialogue et au respect de la Constitution se multiplient, afin d’éviter une escalade de tensions. Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de Droit (HCDDED) pourrait être amené à jouer un rôle de médiation dans les jours à venir.
Sur le plan économique, cette décision pourrait également avoir des répercussions. L’incertitude politique risque d’affecter la confiance des investisseurs et de ralentir certains projets de développement en cours. Les institutions financières internationales appellent à la stabilité et à la continuité de la gouvernance économique, malgré la transition politique en cours.
L’enjeu principal, désormais, réside dans la capacité du gouvernement à organiser rapidement des élections crédibles, transparentes et inclusives. La CENI devra relever un défi logistique et politique considérable pour assurer un scrutin dans des conditions acceptées par tous les acteurs.
Une étape décisive dans l’histoire institutionnelle de Madagascar
La dissolution de l’Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans l’histoire politique contemporaine de Madagascar. Ce geste fort, assumé par le président Andry Rajoelina, reflète à la fois les difficultés structurelles du système politique et la volonté de rétablir un équilibre institutionnel jugé fragile.
Cette décision s’inscrit dans une longue tradition politique où les rapports entre exécutif et législatif ont souvent été marqués par la méfiance et la confrontation. Depuis l’indépendance, les dissolutions et crises parlementaires se sont succédé, traduisant la difficulté du pays à stabiliser durablement ses institutions.
Pour autant, cette dissolution pourrait ouvrir une nouvelle phase de recomposition politique et de renouvellement démocratique, si elle s’accompagne d’un processus électoral transparent et d’un véritable dialogue national. Le président, en assumant cette décision, porte désormais la responsabilité de garantir la légitimité du processus à venir et de restaurer la confiance des citoyens dans la démocratie malgache.
L’histoire retiendra que le 14 octobre 2025, Madagascar a connu un tournant politique majeur. Le décret n°2025-1051, bien plus qu’un simple acte administratif, incarne une volonté de rupture et un appel à la refondation institutionnelle. Mais sa réussite dépendra de la manière dont cette transition sera conduite, entre légalité constitutionnelle, dialogue politique et engagement collectif pour l’avenir du pays.
En définitive, la dissolution de l’Assemblée nationale, telle que décidée par Andry Rajoelina, symbolise à la fois un moment de tension et une opportunité de renouveau. Madagascar entre dans une période de transition délicate, où chaque acteur politique sera appelé à faire preuve de responsabilité pour préserver la paix sociale et garantir la continuité de l’État. Le décret présidentiel du 14 octobre 2025, en dissolvant l’un des piliers du pouvoir républicain, ouvre une page nouvelle de la vie politique nationale dont les contours dépendront des décisions à venir.