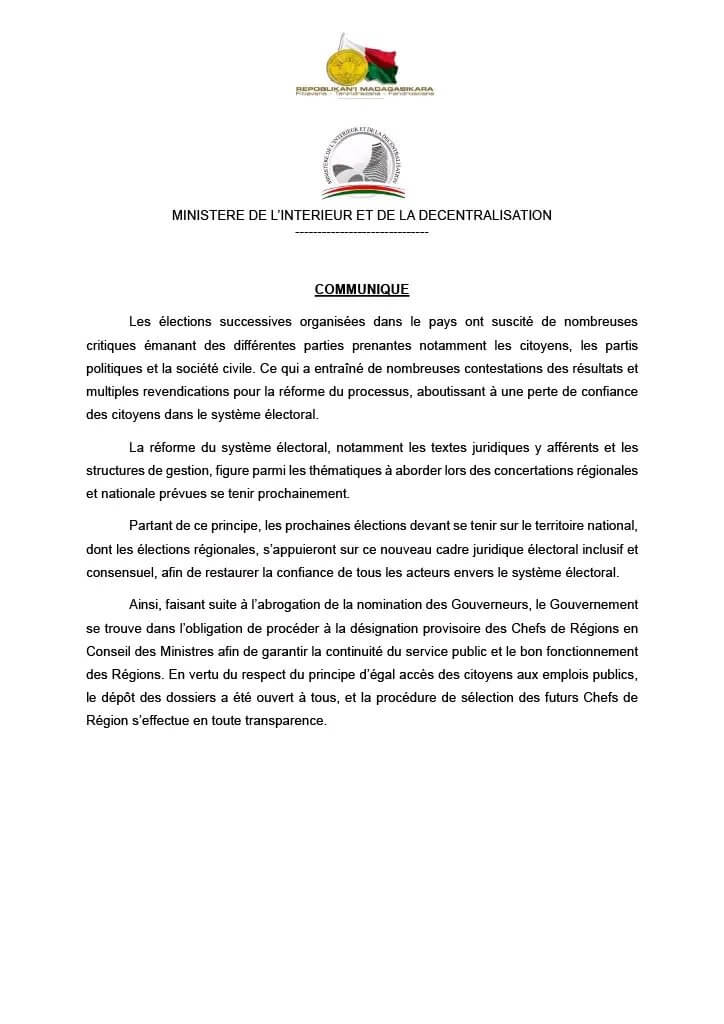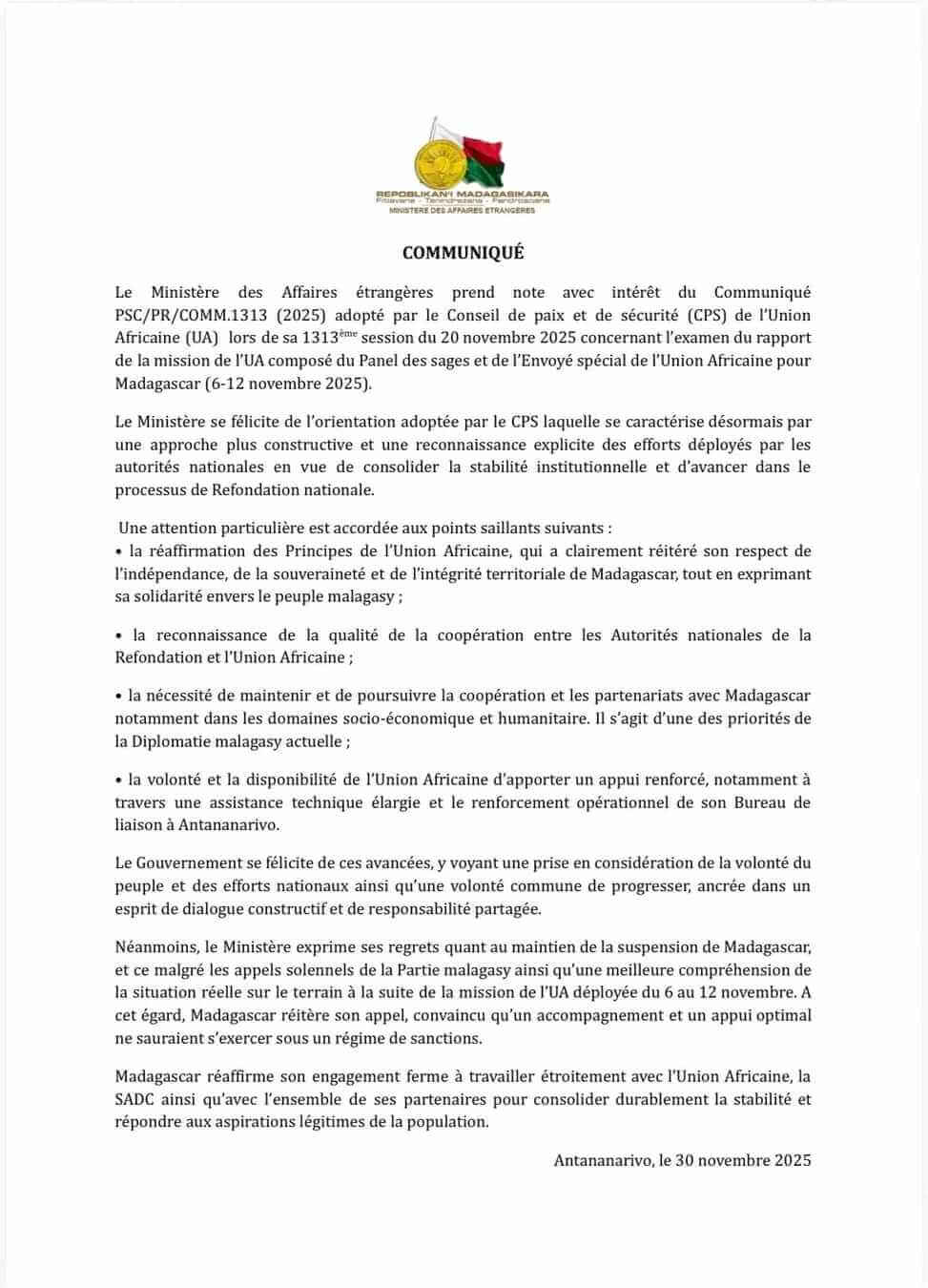La tension politique à Madagascar atteint un nouveau seuil après l’intervention ferme de l’Union africaine (UA). Face à la prise de pouvoir militaire et à la suspension du processus démocratique, l’organisation continentale hausse le ton : elle réclame la mise en place urgente d’un gouvernement de transition civil et la tenue rapide d’élections libres. Derrière cette exigence, se joue bien plus qu’une simple crise politique : c’est la crédibilité du principe démocratique africain, la stabilité régionale et la confiance du peuple malgache dans ses institutions qui sont en jeu.
Un climat politique sous haute tension
Depuis plusieurs semaines, la situation politique à Madagascar s’est dégradée à une vitesse inquiétante. L’armée, invoquant un vide institutionnel et la nécessité de préserver l’ordre public, a pris le contrôle des principaux leviers de pouvoir. Ce coup d’État militaire, qualifié de rupture inconstitutionnelle par de nombreuses organisations internationales, a plongé le pays dans une période d’incertitude politique et sociale.
À la suite de cette prise de pouvoir, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) a invité le colonel Michaël Randrianirina à assumer provisoirement les fonctions de chef de l’État. Cette nomination, censée garantir une transition ordonnée, n’a toutefois pas apaisé les inquiétudes, notamment au sein de la communauté internationale. En effet, la légitimité de cette transition militaire est largement contestée, tant par les partis politiques malgaches que par les partenaires régionaux de l’île.
L’Union africaine, attachée à ses principes fondateurs de respect du constitutionnalisme et de gouvernance démocratique, a rapidement réagi. Son Conseil de paix et de sécurité (CPS) s’est réuni à Addis-Abeba et a rendu un communiqué sans ambiguïté : Madagascar est suspendue de toutes les activités de l’organisation, et les acteurs du coup d’État s’exposent désormais à des sanctions ciblées. Cette décision marque un tournant majeur dans la gestion des crises politiques sur le continent, traduisant la volonté de l’UA d’adopter une ligne de fermeté face aux ruptures de l’ordre constitutionnel.
La fermeté de l’Union africaine : principes et menaces de sanctions
La réaction de l’Union africaine ne s’inscrit pas dans un simple cadre diplomatique. Elle s’appuie sur une doctrine claire et désormais bien établie : la tolérance zéro vis-à-vis des coups d’État militaires. Depuis la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en 2007, l’UA dispose d’un cadre juridique qui l’autorise à suspendre tout État membre ayant accédé au pouvoir par des moyens inconstitutionnels.
Dans le cas malgache, la décision de suspension immédiate s’accompagne d’une mise en garde explicite : les sanctions ne se limiteront pas à des mesures symboliques. Le Conseil de paix et de sécurité envisage d’imposer des restrictions individuelles, notamment le gel des avoirs et l’interdiction de voyager pour les principaux responsables du coup d’État et leurs soutiens. Ces mesures, déjà appliquées par le passé à d’autres pays africains confrontés à des crises similaires — comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso — visent à isoler diplomatiquement et économiquement les putschistes, tout en encourageant le retour à un processus démocratique.
Dans son communiqué, l’Union africaine exhorte les Forces armées malgaches à “respecter de toute urgence et sans condition le principe du constitutionnalisme”. Cette formule, d’apparence juridique, porte une charge politique forte. Elle signifie que l’armée doit se retirer immédiatement des affaires politiques et remettre le pouvoir entre les mains d’une autorité civile légitime. L’organisation rappelle également que la stabilité du pays ne saurait être assurée par la force militaire, mais uniquement par la restauration de l’ordre constitutionnel et la confiance du peuple dans ses institutions.
Un appel à une transition civile encadrée
Au cœur des exigences formulées par l’Union africaine figure la mise en place rapide d’un gouvernement de transition civil. Cette transition, selon les termes de l’organisation, doit être inclusive, transparente et limitée dans le temps. Elle doit surtout ouvrir la voie à des élections “libres, équitables, crédibles et transparentes”.
La transition envisagée ne saurait être une simple formalité institutionnelle. Elle représente un processus complexe, visant à restaurer la légitimité politique du pays et à rétablir la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Pour cela, l’Union africaine propose l’envoi d’une délégation de haut niveau à Antananarivo. Cette mission, composée d’experts politiques, de diplomates et de membres du Comité des sages de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), aura pour objectif d’accompagner les autorités malgaches dans la définition d’une feuille de route consensuelle.
La Commission de l’Union africaine sera également chargée d’apporter un appui technique et logistique au processus électoral. Cette assistance portera notamment sur la mise en place d’une commission électorale indépendante, la révision des listes électorales, la sécurisation du scrutin et la sensibilisation des électeurs. L’objectif affiché est d’éviter toute contestation future des résultats et de garantir une alternance pacifique.
En parallèle, l’UA insiste sur la nécessité d’un dialogue national inclusif. Ce dialogue devrait réunir l’ensemble des forces politiques, la société civile, les représentants religieux et les acteurs économiques. C’est à travers cette concertation nationale que pourra émerger une vision commune de la refondation institutionnelle du pays. L’organisation continentale souligne qu’aucune solution durable ne saurait être imposée de l’extérieur : elle doit émaner de la volonté collective du peuple malgache.
Les réactions internes : entre acceptation et méfiance
Sur la Grande Île, la réaction aux exigences de l’Union africaine reste partagée. D’un côté, le colonel Michaël Randrianirina a affirmé son intention de se conformer à la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Dans un communiqué officiel, le Conseil présidentiel de la Refondation de la République – organe mis en place par les militaires et soutenu par le mouvement de la GenZ – a déclaré vouloir agir “dans un esprit de responsabilité nationale et au nom de la soumission à l’État de droit”.
Cette déclaration, bien que perçue comme un signe d’apaisement, n’a pas convaincu tout le monde. De nombreux acteurs politiques et civiques redoutent que cette soumission apparente ne soit qu’un écran de fumée destiné à gagner du temps. Certains leaders de l’opposition estiment que la transition militaire, même temporaire, risque d’installer un précédent dangereux, remettant en cause les fondements démocratiques du pays.
Dans les rues d’Antananarivo, la population semble divisée entre espoir et scepticisme. Une partie des citoyens, épuisée par les crises politiques successives, réclame avant tout la stabilité et la sécurité. D’autres, en revanche, exigent un retour immédiat à un gouvernement civil et la fin de ce qu’ils perçoivent comme une confiscation du pouvoir par l’armée. Les syndicats, les associations et les intellectuels multiplient les appels à la vigilance, soulignant que seule la transparence et la légitimité démocratique permettront d’éviter une nouvelle dérive autoritaire.
La communauté internationale, quant à elle, se montre prudente mais ferme. Les Nations unies, l’Union européenne et plusieurs partenaires bilatéraux de Madagascar ont exprimé leur soutien à la position de l’Union africaine. Tous appellent à la retenue et au dialogue, tout en conditionnant leur aide économique à la restauration d’un pouvoir civil légitime. Pour un pays dont l’économie dépend largement de l’aide extérieure, cette pression internationale pourrait se révéler déterminante.
Les enjeux régionaux et internationaux de la crise malgache
La crise politique qui secoue Madagascar dépasse largement les frontières nationales. Située au cœur de l’océan Indien, la Grande Île occupe une position stratégique dans la région. Sa stabilité est essentielle, tant pour la sécurité maritime que pour les équilibres économiques et géopolitiques de l’Afrique australe. C’est pourquoi la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) suit de très près l’évolution de la situation.
L’Union africaine, en concertation avec la SADC, entend éviter que le scénario malgache ne se reproduise ailleurs. Ces dernières années, le continent a été confronté à une recrudescence des coups d’État militaires, notamment en Afrique de l’Ouest. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, la fragilité des institutions civiles a souvent servi de prétexte à des interventions armées. En réagissant fermement à Madagascar, l’organisation continentale cherche à envoyer un signal clair : aucune justification ne saurait légitimer la prise du pouvoir par la force.
Sur le plan international, la stabilité de Madagascar est également une préoccupation majeure pour les partenaires étrangers. Le pays abrite des ressources naturelles considérables, notamment des gisements de nickel, de cobalt, de vanadium et de terres rares. Sa position géographique en fait également un point d’intérêt pour les grandes puissances engagées dans la lutte contre la piraterie maritime et les trafics illicites dans l’océan Indien.
La France, ancienne puissance coloniale, observe la situation avec une attention particulière. Elle dispose d’importants intérêts économiques dans le pays et entretient une coopération étroite avec l’armée malgache. De son côté, la Chine, très présente dans le secteur minier, appelle au respect de la souveraineté nationale tout en soutenant la nécessité d’un retour à la stabilité. Les États-Unis, eux, insistent sur la nécessité d’un processus démocratique crédible et menacent de suspendre certains programmes d’aide si la transition n’est pas conforme aux standards internationaux.
Vers une refondation politique et institutionnelle ?
Au-delà de la sortie de crise immédiate, la situation actuelle soulève des questions de fond sur la gouvernance à Madagascar. Depuis son indépendance, le pays a connu de nombreuses alternances politiques, souvent marquées par des tensions, des contestations électorales et des interventions militaires. Ce cycle d’instabilité chronique traduit une fragilité structurelle du système institutionnel malgache.
Pour nombre d’analystes, la crise actuelle pourrait constituer une opportunité de refondation. L’idée d’un nouveau pacte politique, fondé sur une meilleure répartition du pouvoir, une transparence accrue et une plus grande inclusion des forces sociales, gagne du terrain. Certains plaident pour une réforme constitutionnelle visant à clarifier les rapports entre le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire. D’autres insistent sur la nécessité de renforcer les institutions locales afin de rapprocher la gouvernance du citoyen.
L’Union africaine, en prônant un dialogue national inclusif, cherche précisément à encourager ce type de réflexion. Sa vision dépasse la simple restauration d’un pouvoir civil : elle ambitionne de favoriser l’émergence d’une démocratie durable, capable de résister aux crises futures. La réussite de cette démarche dépendra toutefois de la volonté des acteurs malgaches eux-mêmes. Sans une véritable adhésion nationale, toute solution imposée risque d’être perçue comme extérieure et donc illégitime.
La société civile joue ici un rôle déterminant. Les associations, les médias et les universitaires malgaches se mobilisent pour défendre les principes démocratiques et rappeler la nécessité d’un contrôle citoyen sur le pouvoir politique. L’éducation civique, souvent négligée, apparaît comme un enjeu majeur pour consolider la culture démocratique du pays.
Conclusion : un test décisif pour la démocratie africaine
L’exigence de l’Union africaine envers Madagascar dépasse le cadre d’une crise nationale. Elle s’inscrit dans un combat plus vaste pour la consolidation de la démocratie sur le continent africain. En imposant des principes de gouvernance fondés sur le respect de la Constitution et le retour à l’ordre civil, l’organisation affirme sa volonté de rompre avec la banalisation des coups d’État et des transitions militaires.
Mais la route vers la stabilité reste semée d’embûches. La réussite de cette transition dépendra de la capacité des acteurs malgaches à dialoguer, à faire des compromis et à placer l’intérêt général au-dessus des ambitions personnelles. Si la mise en place d’un gouvernement civil de transition et l’organisation rapide d’élections libres parviennent à se concrétiser, Madagascar pourrait redevenir un modèle de résilience démocratique. Dans le cas contraire, le pays risquerait de s’enfoncer dans un cycle de crises récurrentes, compromettant durablement son développement et la confiance de ses citoyens.
Pour l’Union africaine, cette crise est aussi une épreuve de crédibilité. Sa capacité à faire respecter ses décisions et à accompagner efficacement la transition sera observée de près, tant par les autres États membres que par la communauté internationale. Dans un contexte continental marqué par des défis sécuritaires et politiques multiples, l’enjeu est de taille : prouver que l’Afrique peut, par elle-même, défendre ses principes, restaurer la démocratie et construire un avenir fondé sur la légitimité populaire.