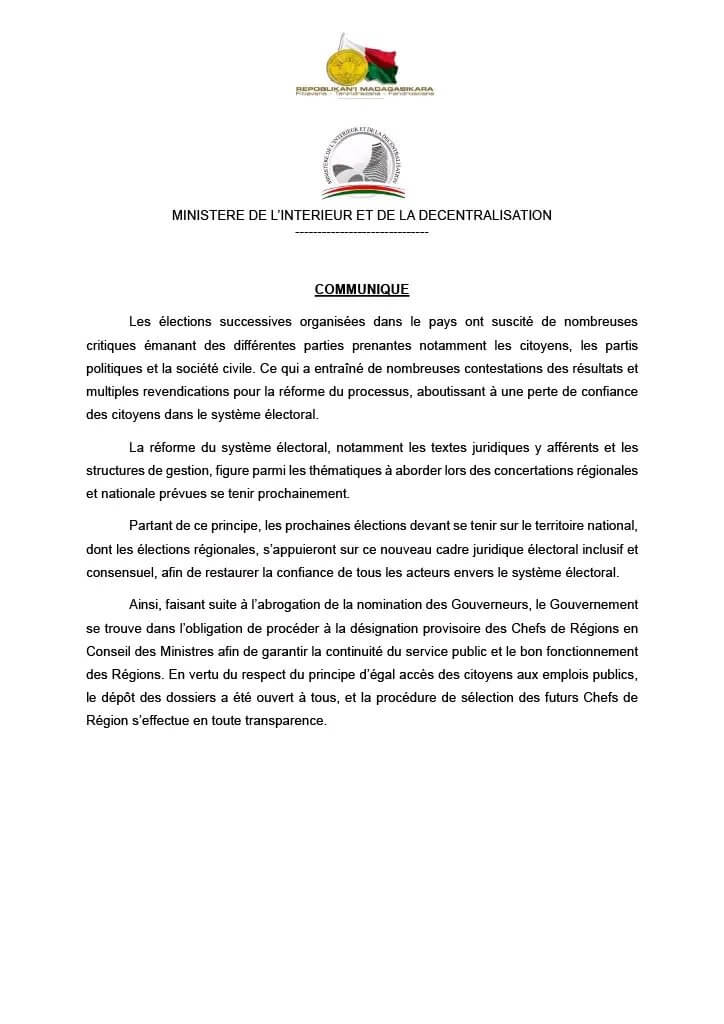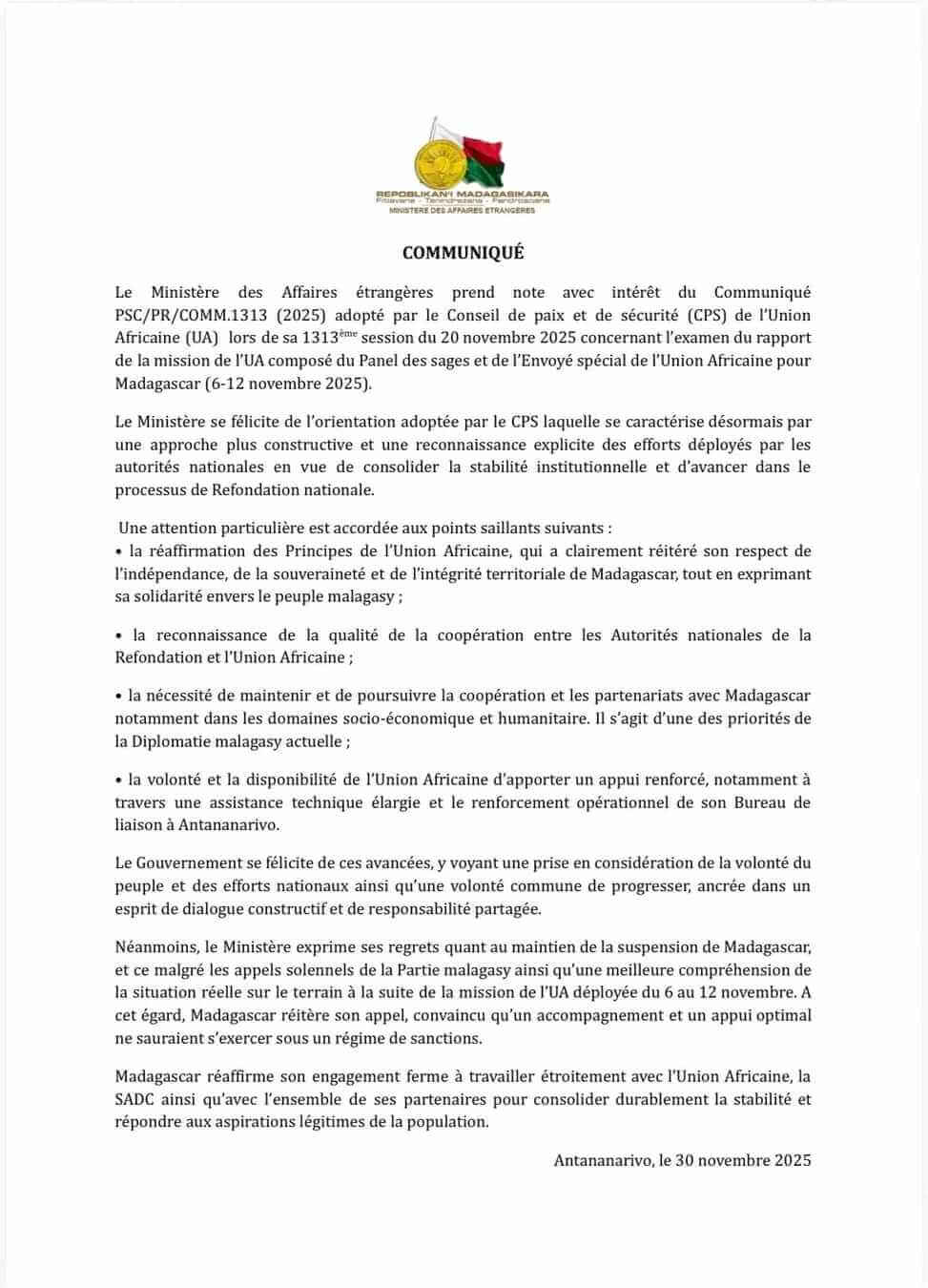La situation politique à Madagascar continue de susciter de vives inquiétudes sur le plan régional et international. Face à l’escalade des tensions institutionnelles et à l’instabilité croissante qui secoue la Grande Île, l’Union africaine (UA) a réaffirmé sa volonté d’intervenir pour favoriser une sortie de crise pacifique. Réuni en session d’urgence lundi dernier, le Conseil de paix et de sécurité de l’organisation continentale a appelé à la retenue et au dialogue entre les acteurs politiques malgaches, tout en se déclarant prêt à appuyer une médiation africaine en coordination avec la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et la Commission de l’océan Indien (COI).
Cette déclaration intervient à un moment critique, alors que Madagascar est plongé dans une crise politique majeure marquée par la dissolution de l’Assemblée nationale, des divisions profondes entre les institutions et un climat de méfiance généralisée entre les forces politiques. Dans un communiqué diffusé lundi soir, l’Union africaine a fait part de sa “profonde préoccupation” quant à l’évolution de la situation, tout en soulignant son attachement au respect de la Constitution et à la préservation de la stabilité nationale.
Une réunion d’urgence du Conseil de paix et de sécurité
La réunion convoquée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine témoigne de la gravité de la situation à Madagascar. Les discussions ont porté sur les récents développements institutionnels, notamment la dissolution du Parlement, les manifestations sporadiques dans plusieurs régions et les tensions croissantes entre le pouvoir exécutif et une partie de la classe politique.
À l’issue de cette session, l’organisation panafricaine a exprimé son inquiétude face à une possible dégradation de la stabilité du pays, rappelant les antécédents de crises qui ont souvent conduit Madagascar à des impasses politiques. L’Union africaine, à travers son Conseil, a réitéré son attachement aux principes de l’ordre constitutionnel et de la gouvernance démocratique. Elle a clairement indiqué qu’elle rejetait tout “changement anticonstitutionnel de gouvernement”, en référence implicite aux risques de renversement institutionnel ou d’intervention militaire.
Le communiqué officiel souligne également la volonté de l’UA d’agir “en coordination étroite” avec les deux organisations régionales les plus directement concernées : la SADC et la COI. Ces deux institutions ont déjà joué un rôle déterminant dans les précédentes crises malgaches, notamment lors de la transition politique de 2009 à 2013, lorsque la SADC avait conduit une médiation ayant abouti à des élections présidentielles pacifiées.
Le Conseil de paix et de sécurité, qui regroupe quinze États membres de l’Union africaine, a rappelé que la stabilité de Madagascar était essentielle non seulement pour la région de l’océan Indien, mais aussi pour l’ensemble du continent africain. L’île, située à un carrefour stratégique, constitue un pôle d’équilibre économique et diplomatique dans la sous-région. Toute détérioration durable de sa situation interne pourrait donc avoir des répercussions régionales.
L’appel de l’Union africaine au dialogue et à la retenue
Au cœur de son message, l’Union africaine a exhorté les différentes forces politiques, civiles et militaires malgaches à faire preuve de responsabilité. “L’ensemble des acteurs doivent privilégier le dialogue dans le cadre constitutionnel et s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver la tension”, précise le communiqué.
Cet appel à la retenue traduit la crainte d’une escalade, alors que plusieurs observateurs évoquent une polarisation croissante entre les partisans du pouvoir en place et ceux de l’opposition. L’organisation continentale redoute que la crise institutionnelle actuelle ne dégénère en affrontements internes, d’autant que les dernières semaines ont été marquées par des mouvements de contestation, des grèves dans les services publics et une défiance accrue vis-à-vis des institutions.
L’Union africaine a également insisté sur la nécessité d’un processus politique “inclusif et dirigé par les Africains”. Cette formule, désormais récurrente dans la diplomatie africaine, traduit la volonté de favoriser une solution endogène, fondée sur les mécanismes régionaux de médiation plutôt que sur des interventions extérieures.
Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à rappeler que la stabilité de Madagascar relevait avant tout de la responsabilité des Malgaches eux-mêmes. Il a toutefois indiqué que l’organisation restait prête à mobiliser ses outils diplomatiques et techniques pour accompagner un dialogue national. Des missions d’évaluation pourraient être dépêchées dans les jours à venir pour rencontrer les parties prenantes et proposer une feuille de route de sortie de crise.
Cette approche privilégie la diplomatie préventive, fondée sur la concertation et la médiation. Elle s’inscrit dans la philosophie de “solutions africaines aux problèmes africains”, que l’Union africaine tente d’ancrer depuis plusieurs années dans sa doctrine politique et sécuritaire.
Le refus d’Andry Rajoelina d’une intervention étrangère
Dans un discours diffusé lundi soir sur les chaînes de télévision malgaches et sur les réseaux sociaux, le président Andry Rajoelina a réagi aux discussions régionales et aux spéculations sur une éventuelle assistance extérieure. Le chef de l’État a confirmé avoir échangé avec plusieurs dirigeants africains, notamment au sein de la SADC, qui lui auraient proposé une aide militaire dans le cadre d’une “mission de pacification”.
Selon ses propos, certains chefs d’État auraient suggéré l’envoi de contingents militaires étrangers, à l’image des interventions déjà menées par la SADC dans d’autres pays de la région, comme la République démocratique du Congo, l’Éthiopie ou encore le Mozambique. Ces propositions, selon le président, auraient été catégoriquement refusées.
“J’ai décliné ces offres parce qu’elles ne correspondent pas à nos valeurs. Madagascar n’a pas besoin de troupes étrangères pour régler ses problèmes internes”, a déclaré Andry Rajoelina. Il a ajouté qu’il s’opposait à tout affrontement entre militaires malgaches, soulignant la nécessité d’éviter toute division au sein des forces armées.
Cette prise de position vise à préserver la souveraineté nationale, mais aussi à prévenir le spectre d’une ingérence étrangère. Le chef de l’État a insisté sur le fait que la solution à la crise devait être malgache avant tout, tout en saluant le soutien diplomatique des partenaires africains.
Cette déclaration a été accueillie avec prudence sur la scène politique nationale. Si certains y voient un geste d’apaisement, d’autres y lisent une volonté de maintenir le contrôle du processus de sortie de crise. Le refus d’une intervention extérieure pourrait également compliquer les efforts de médiation, notamment si les acteurs politiques internes peinent à s’entendre sur un cadre de dialogue commun.
Un contexte de crise institutionnelle profonde
La réaction de l’Union africaine intervient alors que Madagascar traverse l’une de ses crises politiques les plus graves de la dernière décennie. La dissolution de l’Assemblée nationale par décret présidentiel, le 14 octobre 2025, a provoqué une onde de choc sur la scène politique. Cette décision, justifiée par le président Andry Rajoelina comme une réponse à “une impasse institutionnelle”, a été perçue par l’opposition comme une tentative de concentration du pouvoir exécutif.
Depuis, les manifestations de protestation se multiplient dans plusieurs villes du pays. Les syndicats, les partis d’opposition et certaines organisations de la société civile dénoncent un “coup de force constitutionnel” et réclament un retour rapide à l’ordre démocratique.
Le climat politique est d’autant plus tendu que le pays fait face à des difficultés économiques persistantes, marquées par une inflation élevée, une baisse des exportations et une dégradation du pouvoir d’achat. Ces facteurs socio-économiques contribuent à alimenter le mécontentement populaire et accentuent la fragilité du pouvoir en place.
Dans ce contexte, la dissolution de l’Assemblée nationale a ravivé les fractures politiques entre les partisans du président et ses opposants. La perspective d’élections législatives anticipées, si elles sont confirmées, pourrait constituer une issue institutionnelle, mais elle dépendra largement de la capacité des institutions à garantir un scrutin crédible et transparent.
C’est dans ce climat incertain que l’Union africaine, la SADC et la COI tentent d’intervenir pour éviter une dérive politique majeure. Plusieurs observateurs estiment que la situation malgache pourrait rapidement devenir un test pour la diplomatie africaine, souvent critiquée pour sa lenteur face aux crises internes.
Le rôle attendu des organisations régionales
La mise en place d’une médiation africaine concertée impliquerait une coordination étroite entre l’Union africaine, la SADC et la COI. Chacune de ces organisations dispose de leviers diplomatiques et institutionnels pouvant contribuer à un règlement pacifique.
La SADC, qui regroupe seize États d’Afrique australe, a déjà une expérience éprouvée dans la gestion des crises politiques de la région. En 2009, elle avait piloté la médiation qui avait conduit à la fin de la transition malgache après le renversement du président Marc Ravalomanana. À l’époque, le processus de réconciliation nationale avait abouti à l’organisation d’élections libres et à la reconnaissance internationale du nouveau gouvernement.
De son côté, la Commission de l’océan Indien (COI), basée à Maurice, entretient des liens historiques et institutionnels forts avec Madagascar. Elle joue un rôle de passerelle entre les pays insulaires de la région et soutient les initiatives de paix et de développement. Sa participation permettrait d’assurer une approche régionale équilibrée, tenant compte des spécificités de la Grande Île.
Pour l’Union africaine, cette médiation s’inscrit dans une logique de prévention des crises sur le continent. L’organisation cherche à démontrer sa capacité à gérer les tensions internes par le dialogue, sans recours systématique à des solutions militaires ou à des interventions extérieures.
Une mission conjointe UA–SADC–COI pourrait être dépêchée à Antananarivo dans les prochaines semaines, afin d’évaluer la situation sur le terrain et de proposer un mécanisme de concertation. L’objectif serait de favoriser un dialogue inclusif réunissant les représentants du gouvernement, de l’opposition, de la société civile et des institutions religieuses.
Les enjeux d’une médiation africaine pour Madagascar
L’annonce de l’Union africaine constitue une lueur d’espoir pour une issue pacifique à la crise. Cependant, la réussite d’une telle médiation dépendra de plusieurs facteurs : la volonté des acteurs politiques malgaches de dialoguer, la neutralité des médiateurs et la capacité à rétablir la confiance entre les institutions.
Madagascar a déjà connu plusieurs tentatives de médiation par le passé, certaines fructueuses, d’autres avortées. Les expériences de 2002, 2009 et 2010 ont montré que les solutions imposées de l’extérieur ne sont durables que si elles reposent sur un consensus national.
Pour l’heure, la priorité semble être d’éviter une escalade des tensions qui pourrait plonger le pays dans une nouvelle crise institutionnelle. La médiation africaine devra s’appuyer sur des principes de transparence, de respect des droits fondamentaux et d’équilibre entre les pouvoirs.
Au-delà des considérations politiques, cette démarche représente un enjeu symbolique pour l’Union africaine. Réussir à accompagner Madagascar vers une sortie de crise apaisée renforcerait la crédibilité de l’organisation et illustrerait la pertinence du principe de “solutions africaines aux problèmes africains”.
La Grande Île se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif. Entre les incertitudes politiques et les espoirs de stabilité, l’avenir immédiat dépendra de la capacité des dirigeants malgaches à privilégier l’intérêt national sur les rivalités partisanes. L’Union africaine, la SADC et la COI disposent désormais d’une fenêtre d’opportunité pour jouer un rôle de facilitateur et contribuer à la restauration d’un climat politique apaisé.
Conclusion : l’Afrique au chevet de la Grande Île
La crise politique malgache a franchi un nouveau cap, plaçant le pays sous les projecteurs du continent. La décision de l’Union africaine d’offrir ses bons offices, en concertation avec la SADC et la COI, témoigne de la gravité de la situation mais aussi de la volonté africaine d’éviter un nouvel épisode d’instabilité prolongée.
Si l’appel au dialogue et à la retenue lancé par l’UA est entendu, Madagascar pourrait amorcer une sortie de crise par la voie politique et pacifique. Dans le cas contraire, le risque d’un enlisement institutionnel et d’un isolement diplomatique s’accentuerait, compromettant les efforts de développement et la cohésion nationale.
En refusant toute intervention militaire étrangère, le président Andry Rajoelina a réaffirmé la souveraineté du pays, tout en laissant ouverte la voie à une médiation régionale. Le rôle des organisations africaines sera désormais déterminant pour transformer cette crise en opportunité de refondation démocratique.
L’Afrique tout entière observe la Grande Île, espérant que cette fois encore, le dialogue et la concertation triompheront des divisions. L’avenir de Madagascar dépendra, plus que jamais, de la capacité collective de ses dirigeants et de ses partenaires africains à privilégier la paix, la stabilité et la démocratie.