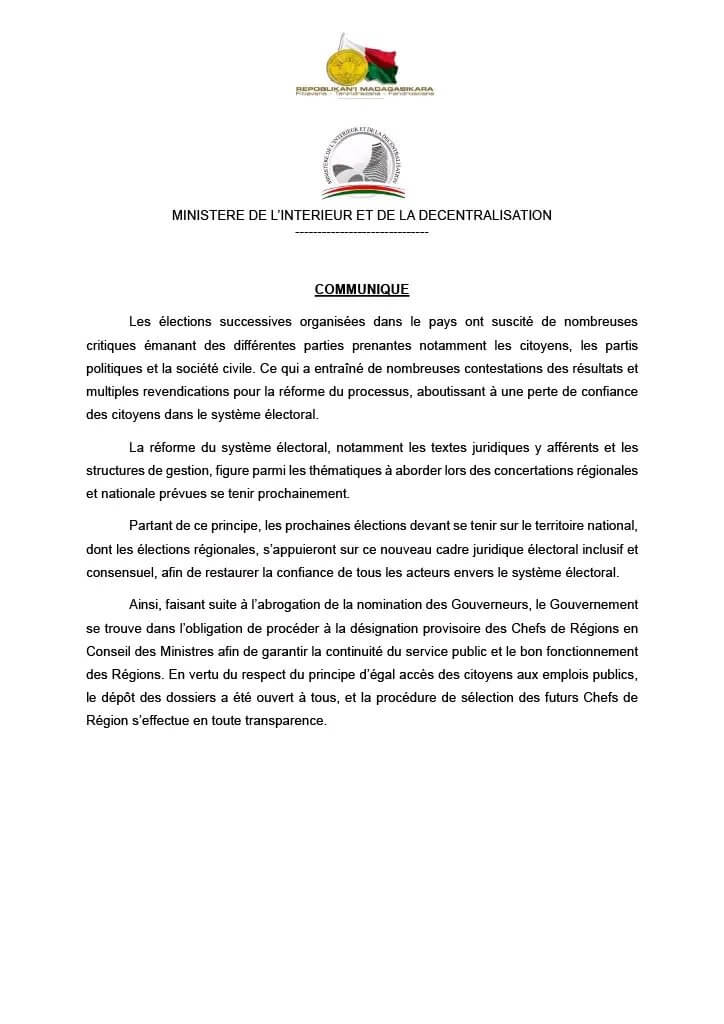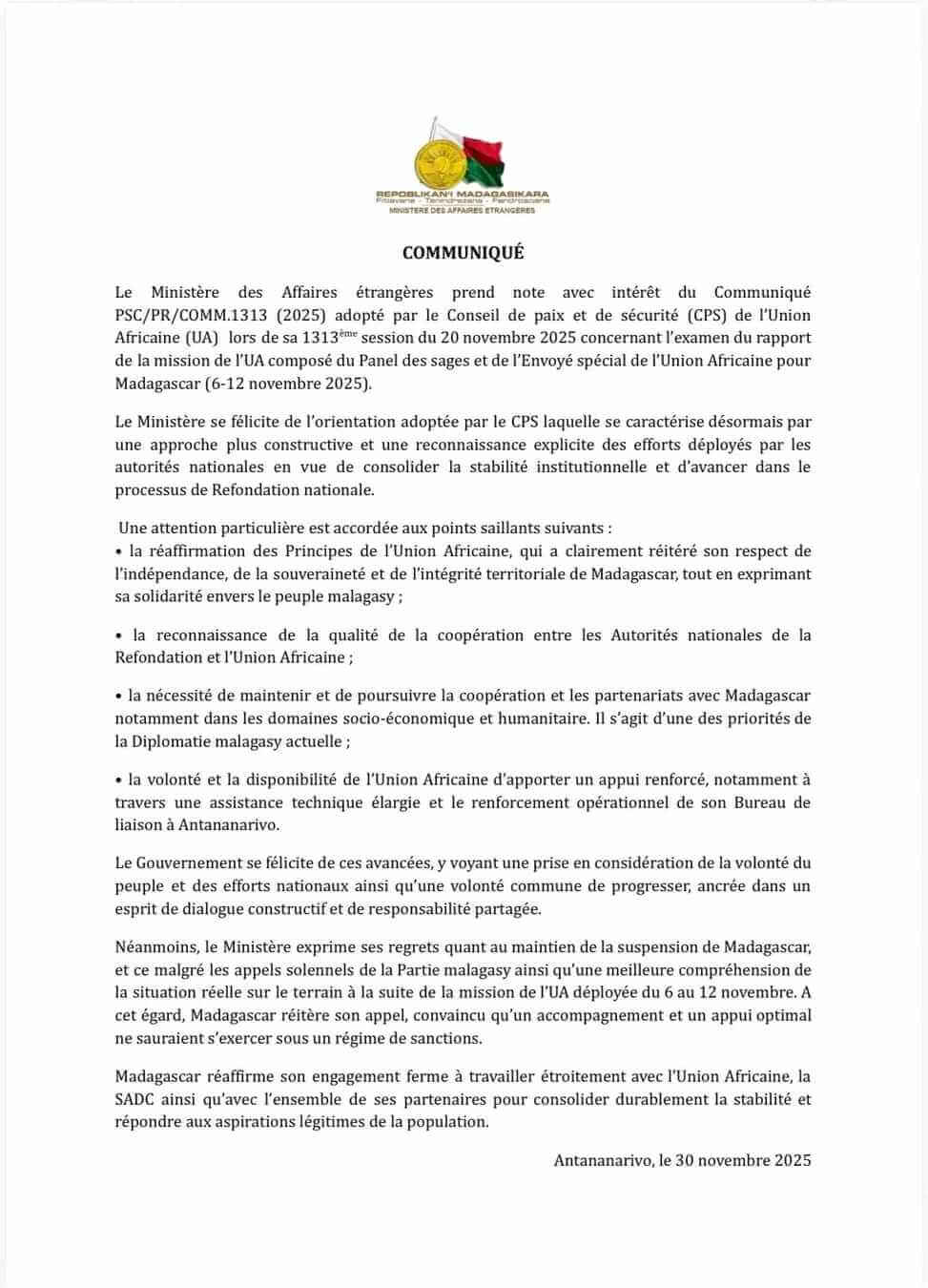À Madagascar, la Chambre haute s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire institutionnelle. Après plusieurs mois de turbulences politiques et de changements successifs à sa tête, le Sénat se prépare à élire son troisième président au cours de la même législature. Cette nouvelle élection, prévue pour la deuxième session ordinaire qui s’ouvrira le 21 octobre 2025, marque une étape cruciale pour la stabilité de l’institution parlementaire. Entre enjeux politiques, équilibres internes et incertitudes, cette recomposition au sommet du Sénat reflète les tensions persistantes qui traversent la vie politique malgache.
Une élection décisive dans un contexte politique tendu
Selon le procès-verbal de la réunion hybride tenue à l’initiative du Bureau permanent du Sénat, l’élection d’un nouveau président figure à l’ordre du jour de la deuxième session ordinaire, qui s’ouvrira le 21 octobre 2025. Elle se tiendra immédiatement après la cérémonie d’ouverture officielle. Cette annonce intervient après une série d’événements qui ont bouleversé la direction de la Chambre haute, minant la confiance et la cohésion entre ses membres.
Le poste de président du Sénat est vacant depuis la mise à l’écart du général Richard Ravalomanana, qui avait lui-même succédé à Herimanana Razafimahefa, destitué en octobre 2023. Ces changements successifs en moins de deux ans traduisent une instabilité institutionnelle préoccupante au sein de la deuxième Chambre du Parlement malgache.
Le Bureau permanent a tenu à rappeler que cette élection est nécessaire pour garantir la continuité des travaux parlementaires et restaurer l’autorité morale de l’institution. Dans l’attente du scrutin, la direction du Sénat est confiée au doyen de l’institution, le sénateur Jean André Ndremanjary. Ce dernier a été chargé d’« expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président », selon les termes du procès-verbal.
Cette période d’intérim doit permettre de préparer sereinement le processus électoral, mais elle s’inscrit dans un contexte politique tendu à Madagascar, marqué par des débats autour de la légitimité institutionnelle et du rôle du Parlement dans la gestion des crises politiques successives.
Un siège présidentiel devenu symbole d’instabilité
L’histoire récente du Sénat malgache illustre la fragilité du cadre institutionnel. En moins de deux ans, trois présidents se sont succédé à la tête de cette institution censée incarner la stabilité et la continuité de l’État. Le premier, Herimanana Razafimahefa, avait été destitué en octobre 2023 à la suite de tensions internes et de désaccords politiques. Son départ avait ouvert une crise au sein même du Sénat, mettant en évidence des divergences profondes entre les sénateurs.
Quelques jours après cette destitution, le général Richard Ravalomanana, nommé sénateur au titre du quota présidentiel le 8 septembre 2023, avait été porté à la présidence le 12 octobre de la même année. Militaire de carrière et ancien proche du pouvoir exécutif, il incarnait alors la volonté de redonner au Sénat une direction plus ferme et plus disciplinée. Toutefois, son mandat aura été bref et marqué par la tourmente politique.
Selon le procès-verbal du Bureau permanent, Richard Ravalomanana aurait confirmé qu’il ne se représenterait pas à la prochaine élection. Il aurait également accepté la demande des membres du Bureau de « céder la présidence à une direction collégiale », au regard de la situation politique actuelle du pays. Cette décision, perçue par certains comme un geste d’apaisement, met un terme à un épisode de fortes tensions internes.
Le départ du général Ravalomanana révèle néanmoins la difficulté de l’institution à maintenir une direction stable et indépendante. En théorie, le Sénat malgache représente la chambre de la sagesse et du recul politique ; en pratique, il apparaît de plus en plus comme un terrain de rivalités et de luttes d’influence entre les différents courants politiques.
Une institution fragilisée mais toujours essentielle
Malgré ces turbulences, le Sénat conserve un rôle important dans l’équilibre des pouvoirs. En tant que seconde Chambre du Parlement, il participe à l’examen et à l’adoption des lois, assure le contrôle de l’action gouvernementale et joue un rôle consultatif dans les grandes décisions de l’État.
Cependant, la succession rapide de ses dirigeants affaiblit sa crédibilité auprès de l’opinion publique et des partenaires institutionnels. Certains observateurs y voient le reflet d’un système politique où les équilibres sont précaires et où les institutions restent vulnérables aux influences extérieures.
La désignation d’un nouveau président en octobre prochain apparaît dès lors comme un test majeur pour la solidité du Sénat. Le scrutin devrait permettre de mesurer la capacité de ses membres à s’accorder sur une personnalité consensuelle, capable de rétablir la confiance et de garantir la neutralité de la Chambre haute.
Selon plusieurs sources parlementaires, une convocation d’une session extraordinaire avant cette date n’est pas totalement écartée. Les députés de l’Assemblée nationale auraient d’ailleurs exprimé le souhait d’une telle réunion, afin de traiter certaines urgences institutionnelles et d’accélérer la transition au sein du Sénat. Cette éventualité montre que la recomposition en cours dépasse le cadre interne de la Chambre haute : elle s’inscrit dans un climat général de réorganisation du pouvoir politique malgache.
Jean André Ndremanjary, le doyen chargé d’assurer la continuité
Dans cette période d’attente, c’est le sénateur Jean André Ndremanjary, doyen de la Chambre, qui a été désigné pour assurer l’intérim. Ce choix, inscrit dans la tradition parlementaire, vise à garantir une gestion neutre et administrative des affaires en cours. Le rôle du doyen n’est pas de gouverner mais d’assurer la continuité jusqu’à l’élection du nouveau président.
Jean André Ndremanjary est une figure respectée du Sénat, connue pour son expérience et sa discrétion. Son mandat temporaire se limite à la supervision des activités administratives et à la préparation logistique de la session parlementaire à venir. Il devra veiller à maintenir le fonctionnement minimal de la Chambre, notamment en ce qui concerne les commissions permanentes et les travaux législatifs en suspens.
Ce choix de continuité est salué comme un gage de stabilité dans une période d’incertitude. Il traduit aussi la volonté des sénateurs d’éviter toute vacance prolongée du pouvoir, qui pourrait fragiliser davantage l’institution. Toutefois, cette gestion provisoire ne saurait se substituer à une direction politique forte, indispensable pour redonner au Sénat sa place dans le jeu institutionnel malgache.
L’enjeu pour le futur président sera de réaffirmer l’autonomie de la Chambre haute face aux influences du pouvoir exécutif et aux pressions partisanes. Dans un système politique où la concentration des pouvoirs reste un sujet sensible, la capacité du Sénat à exercer son rôle de contrepoids est essentielle pour l’équilibre démocratique.
Les enjeux d’une élection à forte portée politique
L’élection du prochain président du Sénat ne se résume pas à un simple changement de leadership interne. Elle constitue un moment clé pour évaluer les rapports de force au sein du paysage politique malgache. En effet, la présidence du Sénat n’est pas seulement honorifique : elle confère à son titulaire un poids institutionnel non négligeable.
En cas de vacance de la présidence de la République, c’est le président du Sénat qui assure l’intérim. Cette disposition constitutionnelle confère à la fonction une dimension stratégique. C’est aussi pour cette raison que la désignation du nouveau président sera scrutée de près par les observateurs et les acteurs politiques.
La classe politique malgache, déjà fragmentée par des rivalités internes, pourrait voir cette élection comme une opportunité de repositionnement. Certains sénateurs proches de la majorité présidentielle chercheront à maintenir une direction alignée sur les orientations du pouvoir exécutif, tandis que d’autres, plus indépendants, plaideront pour une présidence plus autonome et représentative des territoires.
Le profil du futur président devra donc répondre à plusieurs impératifs : compétence institutionnelle, neutralité politique et capacité à restaurer la confiance. Son élection pourrait aussi envoyer un signal fort quant à la maturité démocratique du Sénat, dans un contexte où la stabilité des institutions est un enjeu majeur pour la crédibilité internationale du pays.
Par ailleurs, la présence de plusieurs anciens hauts fonctionnaires et militaires parmi les sénateurs laisse présager une compétition entre profils technocratiques et politiques. L’équilibre entre ces tendances sera déterminant pour définir l’orientation future de la Chambre haute.
Le rôle du Sénat dans la recomposition du pouvoir
Au-delà de l’élection de son président, le Sénat malgache se trouve à un tournant de son rôle politique. Longtemps perçu comme une institution secondaire, il tend à devenir un espace stratégique dans les rapports entre l’exécutif et le législatif. Sa capacité à jouer un rôle de médiation ou de stabilisation politique est désormais attendue par la société civile comme par les observateurs internationaux.
Les crises successives qu’a traversées le pays ont souvent mis en lumière les faiblesses institutionnelles du Parlement. Dans ce contexte, le Sénat peut se positionner comme une chambre de concertation, capable de favoriser le dialogue national. L’élection du nouveau président constituera donc une opportunité pour redéfinir cette mission et renforcer la place du Sénat dans la gouvernance nationale.
De plus, la stabilité interne du Sénat aura un impact direct sur les relations avec les institutions régionales et internationales. Plusieurs projets de coopération, notamment dans le domaine du développement territorial et de la gouvernance locale, dépendent d’une représentation parlementaire efficace et stable. La désignation d’un président crédible et respecté est donc aussi un enjeu diplomatique.
Dans un pays où les crises institutionnelles se succèdent, l’équilibre entre légitimité politique et efficacité administrative devient une exigence. Le futur président du Sénat devra ainsi incarner un leadership rassembleur, capable de réconcilier les différentes sensibilités politiques et de restaurer la confiance du public envers une institution fragilisée.
Une législature marquée par les remous politiques
Cette législature restera sans doute dans l’histoire parlementaire de Madagascar comme l’une des plus mouvementées. Trois présidents en quelques années, des tensions internes persistantes, des changements de majorité et une défiance croissante entre les institutions : autant d’éléments qui traduisent la complexité de la vie politique nationale.
Ces épisodes successifs témoignent aussi d’une évolution profonde du rapport au pouvoir et de la difficulté à instaurer une gouvernance durable. Dans ce contexte, le rôle du Sénat dépasse le simple cadre parlementaire : il devient un espace de consolidation institutionnelle, où se joue en partie l’avenir démocratique du pays.
À quelques jours de l’ouverture de la session ordinaire, l’élection du nouveau président s’annonce déterminante. Elle devra permettre de clore une période de turbulences et de redonner au Sénat la stabilité nécessaire pour remplir pleinement sa mission. Les attentes sont fortes, tant parmi les parlementaires que dans l’opinion publique.
L’avenir du Sénat, et plus largement celui de la démocratie malgache, dépendra de la capacité de ses membres à choisir un dirigeant qui incarne la transparence, le dialogue et la responsabilité politique. Dans une période où les institutions doivent se réinventer, ce scrutin symbolise bien plus qu’un simple changement de présidence : il représente l’espoir d’un nouveau départ pour la Chambre haute et, peut-être, pour le pays tout entier.