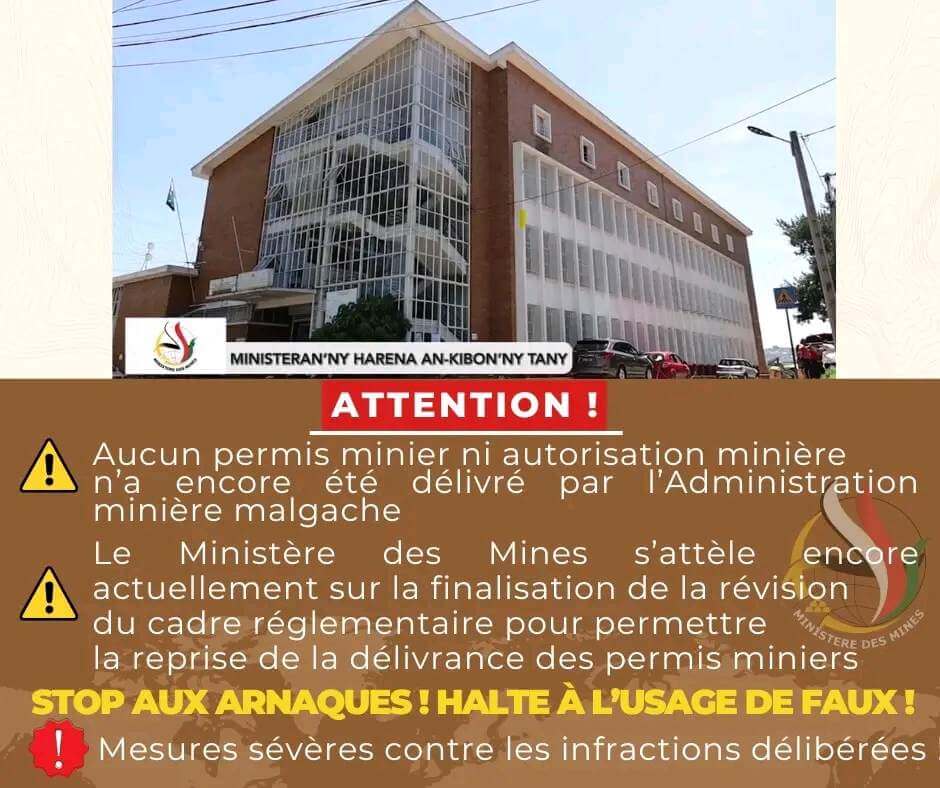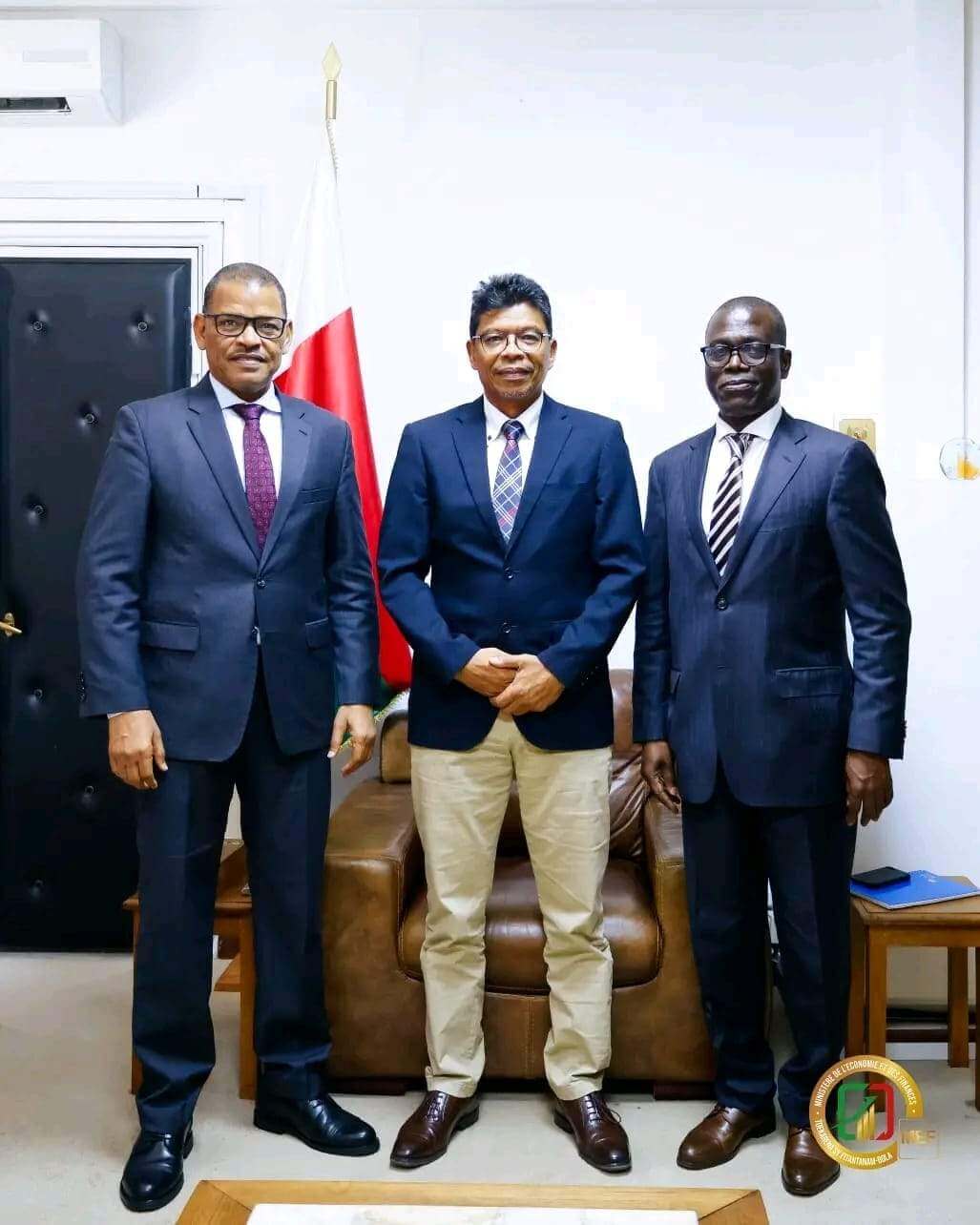L’ariary malgache continue de perdre du terrain face aux grandes monnaies internationales. À la clôture du marché interbancaire des devises (MID) du 16 octobre, le dollar américain s’échangeait à 4 506,17 ariary et l’euro à 5 180,77 ariary, selon les cours de référence publiés par la Banky Foiben’i Madagasikara (BFM). Six mois plus tôt, ces devises valaient respectivement 4 482,31 ariary pour le dollar et 5 040,30 ariary pour l’euro. Cette évolution, bien que modérée, confirme une tendance de fond : la monnaie nationale continue de se déprécier, reflet d’un déséquilibre persistant entre l’offre et la demande de devises.
Cette érosion du pouvoir de l’ariary n’est pas un phénomène isolé. Elle s’inscrit dans un contexte économique fragile où la reprise peine à se consolider, tandis que les pressions inflationnistes demeurent élevées. Les conséquences sont multiples : hausse du coût des importations, perte de compétitivité des entreprises locales, pression sur le budget des ménages, et fragilisation de la stabilité macroéconomique. Derrière les chiffres, c’est la question de la souveraineté monétaire et de la résilience économique de Madagascar qui se pose.
Les causes structurelles de la dépréciation de l’ariary
La faiblesse de l’ariary résulte d’un ensemble de facteurs structurels et conjoncturels. Parmi eux, la demande croissante de devises étrangères occupe une place centrale. Les entreprises importatrices, notamment celles des secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire et du commerce, doivent convertir davantage d’ariary pour payer leurs fournisseurs à l’étranger. Les importations de carburants, en particulier, exercent une pression constante sur le marché des changes.
Dans le même temps, les entrées de devises issues des exportations, du tourisme et des transferts de la diaspora demeurent insuffisantes. Le ralentissement de la demande mondiale, conjugué à la baisse des prix de certaines matières premières exportées par Madagascar (vanille, nickel, cobalt, produits textiles), a limité les recettes en devises. Le tourisme, bien qu’en reprise progressive après la pandémie, n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant-crise.
À cela s’ajoute un contexte macroéconomique national tendu. L’inflation reste élevée, érodant le pouvoir d’achat des ménages et pesant sur la demande intérieure. Les dépenses publiques, notamment celles liées aux subventions énergétiques et aux projets d’infrastructures, accentuent la pression budgétaire. Enfin, la balance commerciale demeure déficitaire, traduisant la dépendance structurelle du pays aux importations. Ces déséquilibres contribuent à affaiblir la confiance dans la monnaie locale.
L’impact sur le coût de la vie et le pouvoir d’achat
La dépréciation de l’ariary se traduit concrètement par une hausse du coût de la vie. Les produits importés, qu’il s’agisse de carburants, de denrées alimentaires ou de biens de consommation courante, voient leurs prix augmenter au rythme de la perte de valeur de la monnaie nationale. Le litre d’essence, indexé sur les cours internationaux du pétrole et sur le taux de change, devient mécaniquement plus cher. Cette hausse se répercute ensuite sur le transport, la logistique et, in fine, sur les prix des produits de première nécessité.
Pour les ménages, cette spirale est particulièrement difficile à supporter. Les salaires, souvent peu ajustés à l’inflation, ne suivent pas la même progression que les prix. Le panier moyen s’alourdit, tandis que les revenus réels stagnent ou diminuent. Les classes moyennes, déjà fragilisées, réduisent leurs dépenses, et les ménages les plus modestes se retrouvent dans des situations de précarité croissante.
Les commerçants, eux aussi, subissent les effets de la volatilité du change. Les marges se réduisent, car répercuter totalement la hausse des coûts sur les prix de vente reviendrait à perdre une partie de la clientèle. Certaines petites entreprises se voient contraintes de réduire leurs importations ou de chercher des fournisseurs alternatifs, souvent au détriment de la qualité ou de la fiabilité.
L’effet le plus visible reste celui de l’inflation importée : plus l’ariary se déprécie, plus les biens venus de l’étranger coûtent cher. Dans un pays où une large part des produits consommés proviennent de l’extérieur, cette mécanique a des conséquences directes sur la stabilité sociale et sur la perception de la situation économique.
Le rôle de la Banky Foiben’i Madagasikara et les marges de manœuvre limitées
Face à cette tendance, la Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) joue un rôle essentiel de régulateur. Sa mission consiste à maintenir la stabilité monétaire, à gérer les réserves en devises et à assurer un fonctionnement ordonné du marché interbancaire. La BFM peut intervenir de plusieurs façons : en vendant ou en achetant des devises pour influencer le taux de change, en ajustant les taux directeurs pour contrôler la liquidité, ou encore en édictant des mesures destinées à encadrer les mouvements de capitaux.
Cependant, les marges de manœuvre de la banque centrale restent limitées. Les réserves en devises du pays, bien qu’en amélioration par rapport à certaines périodes critiques, demeurent vulnérables aux chocs externes. Une intervention trop massive risquerait d’épuiser ces réserves et de fragiliser la position financière du pays. De plus, la BFM doit concilier plusieurs objectifs : soutenir la stabilité du change, contenir l’inflation et préserver la croissance.
Dans un contexte où les pressions inflationnistes sont déjà fortes, une politique monétaire trop restrictive pourrait freiner l’activité économique. À l’inverse, un laxisme excessif risquerait d’alimenter la fuite devant la monnaie nationale. C’est un équilibre délicat que la BFM doit constamment rechercher.
Par ailleurs, le taux de change flottant adopté par Madagascar implique que la valeur de l’ariary dépend largement des forces du marché. Les interventions de la banque centrale ne visent donc pas à fixer un niveau précis de la monnaie, mais à éviter des fluctuations excessives. Le défi consiste à maintenir la confiance dans la politique monétaire tout en adaptant les instruments de régulation aux réalités économiques du moment.
Les conséquences économiques à moyen terme
La dépréciation continue de l’ariary ne se limite pas à des effets immédiats sur les prix. À moyen terme, elle a des implications plus profondes sur la structure économique du pays. D’un côté, une monnaie plus faible peut, en théorie, favoriser les exportations en rendant les produits malgaches plus compétitifs à l’étranger. Cependant, cet avantage reste limité par la faible diversification du tissu productif national et par la dépendance des exportateurs aux importations de biens intermédiaires.
Les entreprises exportatrices, notamment dans les secteurs de la vanille, du textile ou des minerais, voient certes leurs recettes en devises augmenter, mais elles subissent aussi la hausse des coûts des intrants importés. L’effet net sur leur rentabilité demeure donc incertain.
Sur le plan des investissements, la dépréciation peut décourager les capitaux étrangers à court terme. Les investisseurs internationaux recherchent avant tout la stabilité et la prévisibilité. Une monnaie trop volatile accroît les risques de change et peut détourner les flux vers d’autres destinations perçues comme plus sûres. Cela pourrait ralentir les projets d’investissement, notamment dans les secteurs à forte intensité capitalistique comme l’énergie, les infrastructures ou l’agro-industrie.
Sur le plan macroéconomique, un affaiblissement prolongé de la monnaie nationale tend à alourdir la dette extérieure, surtout lorsque celle-ci est libellée en devises. Chaque dollar ou euro à rembourser coûte plus cher en ariary. Ce mécanisme accroît la charge de la dette publique et limite les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement.
Enfin, l’impact social ne saurait être sous-estimé. La perte de pouvoir d’achat alimente la frustration, fragilise la cohésion sociale et accentue les inégalités. Dans un pays où une large partie de la population vit déjà en dessous du seuil de pauvreté, les effets d’une inflation importée peuvent être dévastateurs.
Les pistes pour renforcer la résilience monétaire et économique
Face à cette situation, plusieurs leviers peuvent être envisagés pour stabiliser la monnaie nationale et renforcer la résilience de l’économie malgache. Le premier consiste à accroître la capacité du pays à générer des devises. Cela passe par la diversification des exportations, le développement du tourisme durable, la valorisation des ressources naturelles, et le soutien aux industries locales capables de se positionner sur les marchés internationaux.
Le second levier réside dans la maîtrise des importations. Encourager la production locale de biens de consommation courante, notamment dans l’agroalimentaire, permettrait de réduire la dépendance extérieure. Les politiques de substitution aux importations, bien qu’exigeantes en termes d’investissements et de planification, constituent une piste sérieuse pour rééquilibrer la balance des paiements.
La modernisation du secteur financier représente également un axe prioritaire. Le renforcement de la bancarisation, la numérisation des paiements et l’amélioration de l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises pourraient stimuler la croissance interne et renforcer la confiance dans la monnaie locale.
Parallèlement, la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques demeurent essentielles. Réduire les déficits, améliorer la collecte fiscale et limiter les dépenses improductives contribueraient à stabiliser le cadre macroéconomique et à restaurer la crédibilité budgétaire.
Enfin, la coopération internationale, notamment avec les partenaires techniques et financiers, peut jouer un rôle déterminant. Les appuis budgétaires, les programmes de réforme structurelle et les projets d’investissement ciblés peuvent aider Madagascar à consolider ses réserves en devises et à renforcer la résilience de son économie.
Une situation révélatrice des fragilités structurelles du pays
La dépréciation de l’ariary ne constitue pas seulement un indicateur monétaire : elle reflète des déséquilibres plus profonds. Elle met en lumière la dépendance du pays aux importations, la faiblesse de sa base industrielle, la vulnérabilité de ses exportations aux chocs externes et la lenteur de la transformation économique.
Le défi pour les autorités malgaches ne consiste donc pas uniquement à stabiliser le taux de change, mais à engager une réflexion plus large sur le modèle de développement. Le renforcement de la production locale, la valorisation des ressources humaines et naturelles, la modernisation des infrastructures et l’amélioration de la gouvernance économique sont autant de chantiers nécessaires pour inverser la tendance.
Sur le plan social, la préservation du pouvoir d’achat des ménages reste une priorité. Les politiques de soutien ciblées, qu’il s’agisse de subventions aux produits essentiels, de programmes de transfert monétaire ou de mesures de contrôle des prix, peuvent atténuer les effets les plus immédiats de la dépréciation. Mais elles ne constituent qu’un palliatif temporaire. À long terme, seule une croissance inclusive et soutenue permettra de stabiliser durablement la situation monétaire.