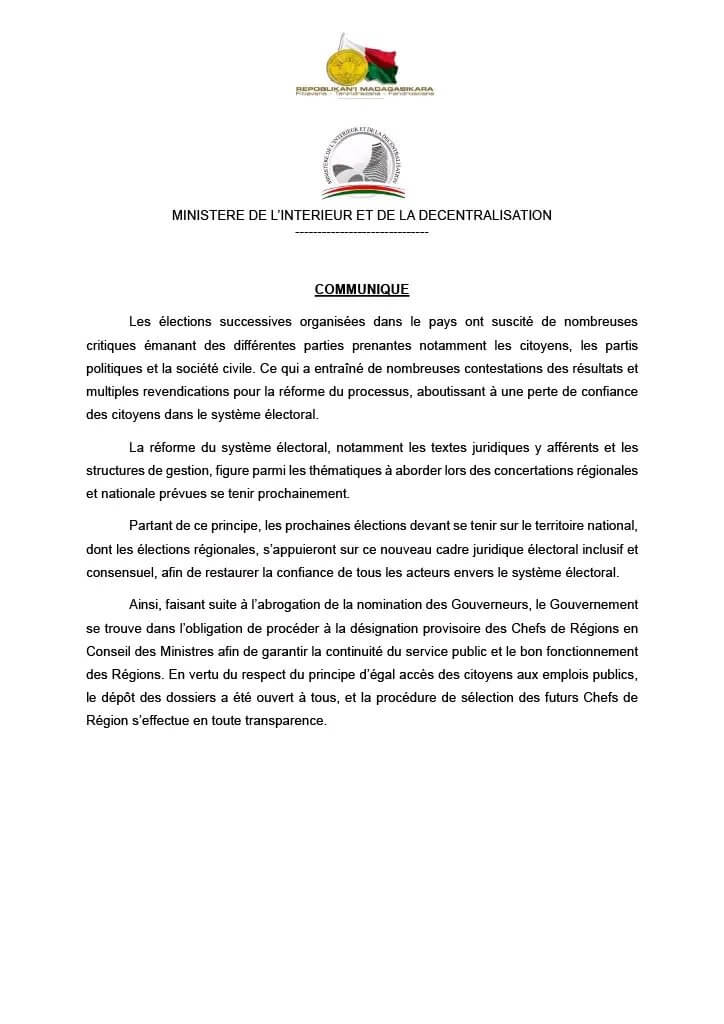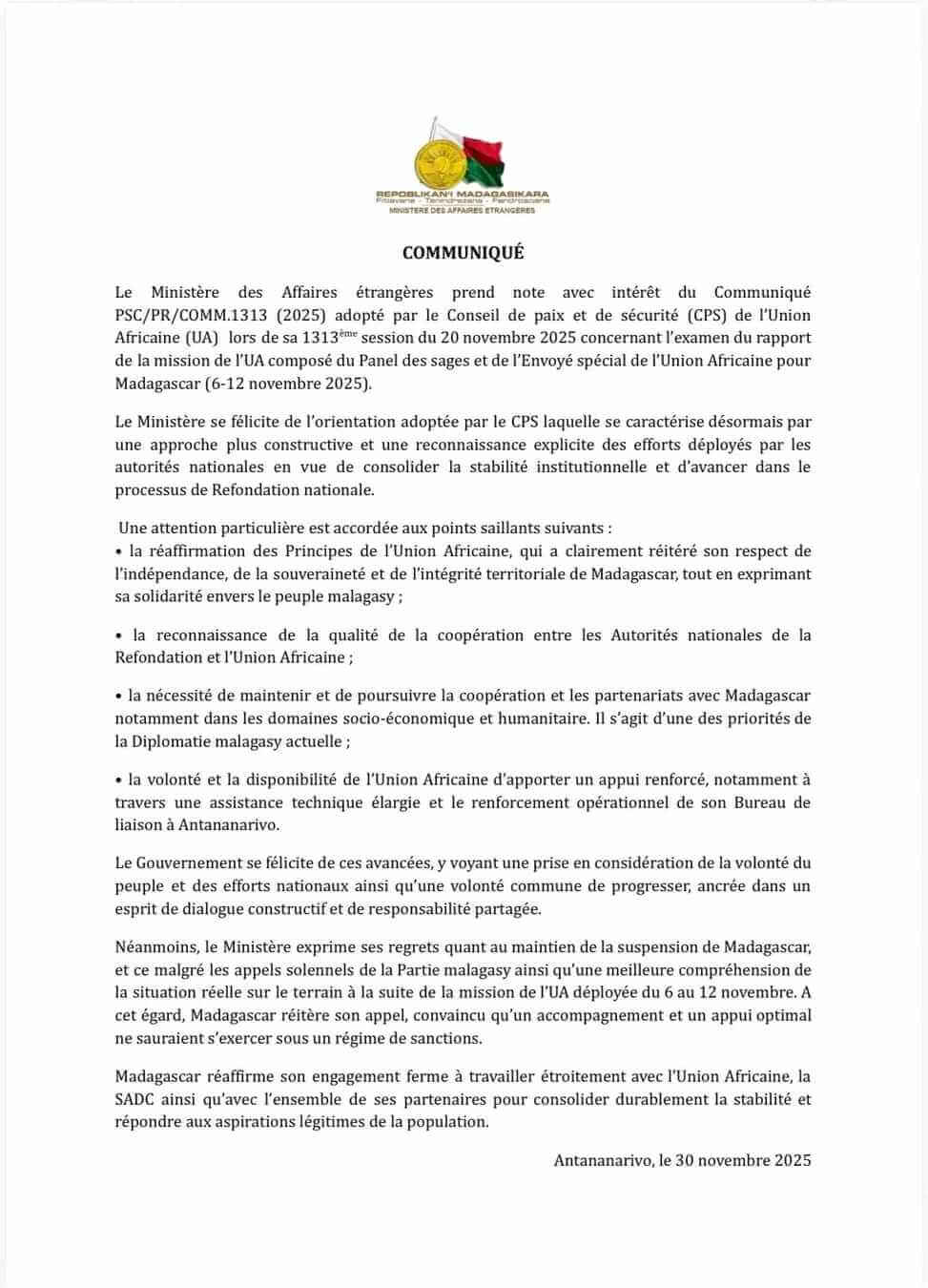Ce jeudi matin, le colonel Michaël Randrianirina — désigné chef de l’État de transition — s’est adressé à la presse nationale dans un contexte politique chargé. Au cœur de son allocution, il a tenu à recadrer la nature de la prise de pouvoir récente, rejetant l’idée d’un coup d’État ou d’un régime purement militaire. Il s’est appuyé sur la décision émise le 14 octobre 2025 par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la décision n° 10-HCC/D3, laquelle prévoit l’organisation d’une élection présidentielle dans un délai de 30 à 60 jours après constatation de vacance de la présidence. Toutefois, le nouveau chef de la Refondation de la République a fermement déclaré qu’un tel calendrier n’était pas réaliste, et qu’il était essentiel de revoir le fonctionnement et la structure de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), jugée fortement contestée par une partie de la population. Il s’est aussi voulu rassurant quant à la nature du futur gouvernement et à l’impératif d’une action tourné vers le peuple.
Dans cet article, nous analysons en profondeur les principaux éléments de ce discours, leurs implications constitutionnelles, les défis logistiques de la transition, les critiques potentielles et les perspectives politiques pour Madagascar.
Le fondement juridique invoqué : la décision de la Haute Cour Constitutionnelle
Le colonel Randrianirina s’est attaché à rappeler que sa prise de fonctions ne se fondait pas sur une action unilatérale ou une insurrection, mais bien sur une autorité constitutionnelle : la Haute Cour Constitutionnelle. En effet, la décision n° 10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 a constaté la vacance de la présidence de la République, en déclarant l’impossibilité pour l’ancien président d’exercer ses fonctions, et a invité une autorité militaire compétente — le colonel Randrianirina — à assumer les fonctions de chef de l’État, avec mission de prendre les mesures nécessaires dans un cadre limité. La HCC a également fixé un délai de 30 à 60 jours pour la tenue d’une nouvelle élection présidentielle.
Ce raisonnement s’inscrit dans un cadre constitutionnel strict : selon l’article 52 de la Constitution malgache, en cas de vacance de la présidence pour quelque cause que ce soit, c’est la HCC qui constate cette vacance, et l’article 53 prévoit la tenue d’une élection dans un délai légal minimal (30 jours) et maximal (60 jours). La décision publiée le 14 octobre 2025 reprend explicitement ces dispositions.
Le colonel Randrianirina a ainsi cherché à conférer une aura de légalité à sa transition, en soulignant que l’initiative ne provient pas d’une prise de pouvoir brutale mais d’une « invitation » exercée par la plus haute juridiction constitutionnelle du pays. Cet argument cherche à neutraliser les accusations immédiates de rupture de l’État de droit ou de putsch.
Cependant, même si le fondement juridique existe sur le papier, la réalité de la mise en œuvre renvoie à de multiples défis : acceptation politique, défi logistique et perceptions populaires. Le simple rappel d’une décision constitutionnelle ne garantit pas la légitimité. C’est là qu’intervient la suite du discours du colonel.
La prudence affichée : respect de la Constitution et réformes institutionnelles
Au cours de son intervention, Randrianirina a tenu à poser une limite claire à ses ambitions : « Si la Constitution le permet, on changera les institutions. Si elle ne le permet pas, on ne le fera pas. » Cette phrase, apparemment anodine, recèle en fait une stratégie prudente : elle laisse ouverte la possibilité de réformes institutionnelles profondes, tout en affirmant une forme de respect de l’ordre juridique actuel.
Cette posture peut être interprétée comme un calibrage subtil : d’un côté, elle rassure ceux qui craignent un coup d’autorité, en affirmant la primauté du droit constitutionnel ; de l’autre, elle laisse la porte ouverte à des modifications majeures, notamment du côté de la CENI, que le colonel a explicitement désignée comme nécessitant une refonte.
La critique fréquemment adressée à la CENI est sa partialité présumée ou son inefficacité. Dans le contexte de fortes contestations populaires, le maintien d’une CENI telle quelle risquerait de miner la confiance dans l’élection à venir. En prenant position dès le départ sur la nécessité de revoir son fonctionnement ou sa structure, Randrianirina anticipe les résistances et cherche à légitimer des réformes avant même la tenue du scrutin.
Toutefois, ce type de démarche doit se faire dans le cadre d’un débat large, transparent, avec la participation de la société civile, des partis politiques et des experts. Le « on changera si la Constitution le permet » peut aussi apparaître comme un prétexte pour contourner les garde-fous, si les réformes sont imposées sans consensus. La tension entre urgence et légitimité va sans doute marquer toute la période de transition.
Vers un gouvernement « majoritairement civil » : promesse d’ouverture
Pour tempérer la dimension militaire de sa transition, le colonel Randrianirina a annoncé que la future composition du gouvernement serait « majoritairement civile ». Par cette formule, il entend sans doute ménager les sensibilités politiques et sociales : un gouvernement intégrant des civils — issus de la société civile, des partis ou de la technocratie — peut faciliter l’acceptabilité du pouvoir et limiter les accusations de militarisme.
Dans un contexte de transition, la question de l’inclusion est cruciale. Si le pouvoir est perçu comme restreint à un cercle militaire fermé, la contestation pourrait s’amplifier. En revanche, un gouvernement pluraliste, mêlant militaires et civils, pourrait favoriser un climat d’apaisement. Le colonel a ainsi cherché à projeter une image de modération.
L’enjeu sera toutefois concret : qui seront les civils associés ? Avec quels pouvoirs ? Comment garantir leur indépendance vis-à-vis de l’appareil militaire dominant ? La promesse d’un caractère majoritairement civil n’est pas en elle-même une garantie de légitimité, mais elle ouvre une fenêtre de possibilité politique. Si les nominations se font dans l’opacité ou selon des affinités militaires, le risque de rejet populaire est élevé.
La nomination du Premier ministre interviendra après la prestation de serment prévue le vendredi 17 octobre, selon les annonces, ce qui constituerait un premier indicateur de la tonalité politique du gouvernement à venir.
Le calendrier contesté : entre décision constitutionnelle et réalités de terrain
Par l’effet de la décision de la HCC, le délai légal pour organiser une élection présidentielle est fixé entre 30 et 60 jours à compter de la constatation de la vacance. Or, dès son discours, le colonel Randrianirina a écarté cette possibilité, arguant que ce calendrier était impraticable. Il justifie ce choix par la complexité de l’organisation, la contestation autour de la CENI et la nécessité préalable de réformes institutionnelles.
Ce rabattement entre la théorie constitutionnelle et la pratique pose une question centrale : dans quelle mesure une décision constitutionnelle peut-elle être modulée par les réalités du terrain ? Le colonel semble plaider pour une adaptation pragmatique — ce que certains qualifieront de flexibilité — tandis que d’autres y verront une tentative de prolonger indûment la transition.
Les contraintes techniques sont réelles : logistique électorale, enrôlement des électeurs, sécurisation des bureaux de vote dans un contexte potentiellement tendu, formation des cadres, etc. Mais ces contraintes ne sauraient à elles seules justifier un dépassement substantiel du délai fixé par la HCC, sauf à fragiliser la légitimité de la transition.
Le défi sera de trouver une balance : avancer suffisamment rapidement pour respecter l’essence de la décision constitutionnelle, tout en ménageant les réformes indispensables pour garantir une élection crédible. Le colonel devra convaincre les acteurs politiques, la société civile et l’opinion publique qu’il agit non par velléité prorogatoire, mais par souci d’un scrutin de qualité.
Rapport à la population et légitimité populaire : la clé de la transition
Dans son discours, Randrianirina n’a pas limité son adresse aux institutions ; il a souligné que l’action du nouveau pouvoir devrait rester « tournée vers le peuple et ses attentes ». Cette mention, plus symbolique qu’opérationnelle dans un premier temps, indique une volonté de bâtir une légitimité fondée sur l’adhésion populaire.
Mais entre les mots et la pratique, l’écart peut être grand. Pour que cette promesse soit crédible, la transition devra non seulement organiser une élection, mais le faire dans un climat d’ouverture, de transparence et de participation. Cela implique :
- une concertation véritable avec les partis politiques, les associations, les leaders d’opinion ;
- un calendrier clair et respecté, avec des mécanismes de suivi indépendants ;
- une communication régulière et sincère avec la population, sans monopole d’État ;
- des garanties de sécurité pour le déroulement du processus électoral ;
- un cadre juridique stable, sans changements systémiques brusques sans débat.
Le colonel a d’ores et déjà placé la barre haut. Si sa transition se contente d’imposer un calendrier flou, de multiplier les réformes autoritaires ou de privilégier les intérêts militaires, le rejet populaire pourrait être brutal. À l’inverse, s’il parvient à faire de cette transition une période de remodelage institutionnel inclusif, il pourrait laisser une empreinte positive.
Enjeux critiques et risques potentiels
À travers cette transition, plusieurs enjeux sensibles émergent. D’abord, le pouvoir devra résister à la tentation de prolonger indéfiniment la transition sous prétexte de « besoin de temps ». Les acteurs internes (partis, personnalités politiques) et externes (pays partenaires, organisations internationales) surveilleront avec attention le respect du calendrier électoral et le respect des principes démocratiques.
Ensuite, la réforme de la CENI sera un point de tension majeur. Si elle est perçue comme imposée par le pouvoir militaire sans consultation ou transparence, elle pourra se retourner contre lui. Il faudra bâtir un consensus sur sa nouvelle structure, ses modes de nomination, ses garanties d’indépendance, ses ressources.
Par ailleurs, la justice, la presse, les libertés publiques et le contrôle institutionnel devront être préservés pendant la transition. Tout glissement autoritaire, même progressif, sera vécu comme une trahison de la promesse d’un retour à l’ordre constitutionnel.
Enfin, l’acceptabilité populaire est une condition indispensable. La fracture sociale et régionale à Madagascar est profonde. Certains pourraient voir dans cette transition une opportunité de réforme et d’espoir, d’autres un simple redéploiement du pouvoir militaire. Le colonel et son entourage devront trouver des réponses crédibles aux défis socioéconomiques, à la remise à niveau de l’État, au renouveau d’une gouvernance respectueuse des droits.
Conclusion : une transition sous haute tension
Le discours du colonel Michaël Randrianirina marque le lancement d’une transition aux frontières incertaines entre légalité formelle, pragmatisme et contestation potentielle. En affirmant que sa démarche repose sur une décision de la Haute Cour Constitutionnelle, en promettant un gouvernement majoritairement civil et en revendiquant une démarche tournée vers le peuple, il cherche à légitimer une période d’exception.
Mais ce défi est immense : concilier le respect de la Constitution et l’imperatif de reformes institutionnelles, tenir un calendrier électoral crédible tout en garantissant une élection libre et transparente, bâtir la confiance populaire dans un contexte de défiance.
La réussite ou l’échec de cette transition dépendra moins des discours que des actes. Le colonel Randrianirina et les acteurs de l’État en transition doivent démontrer que cette période ne sera pas simplement un entre-deux vide de sens, mais une étape de reconstruction politique profonde. Si l’équilibre n’est pas trouvé, le risque de crise institutionnelle pourrait se renforcer, plongeant Madagascar dans une incertitude prolongée.
Ce jeudi matin, les mots ont été prononcés. Mais c’est dans les semaines à venir que se décidera la trajectoire du pays. La nation attend des actes à la hauteur des promesses — et la clé de cette transition se joue dans l’art de concilier rigueur constitutionnelle et pragmatisme réformateur.