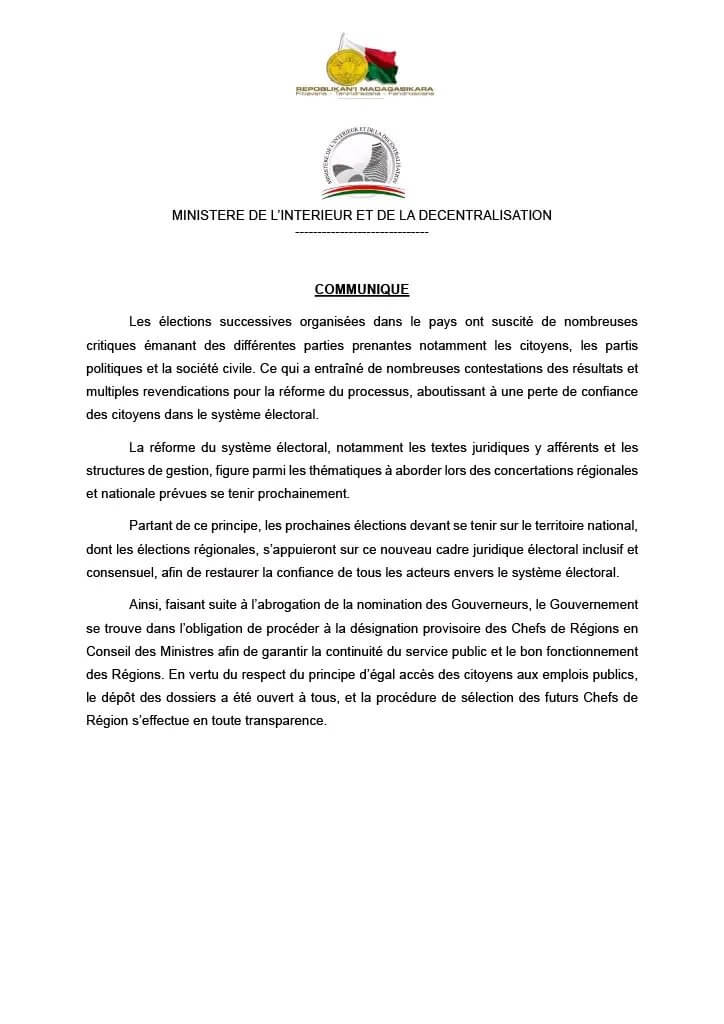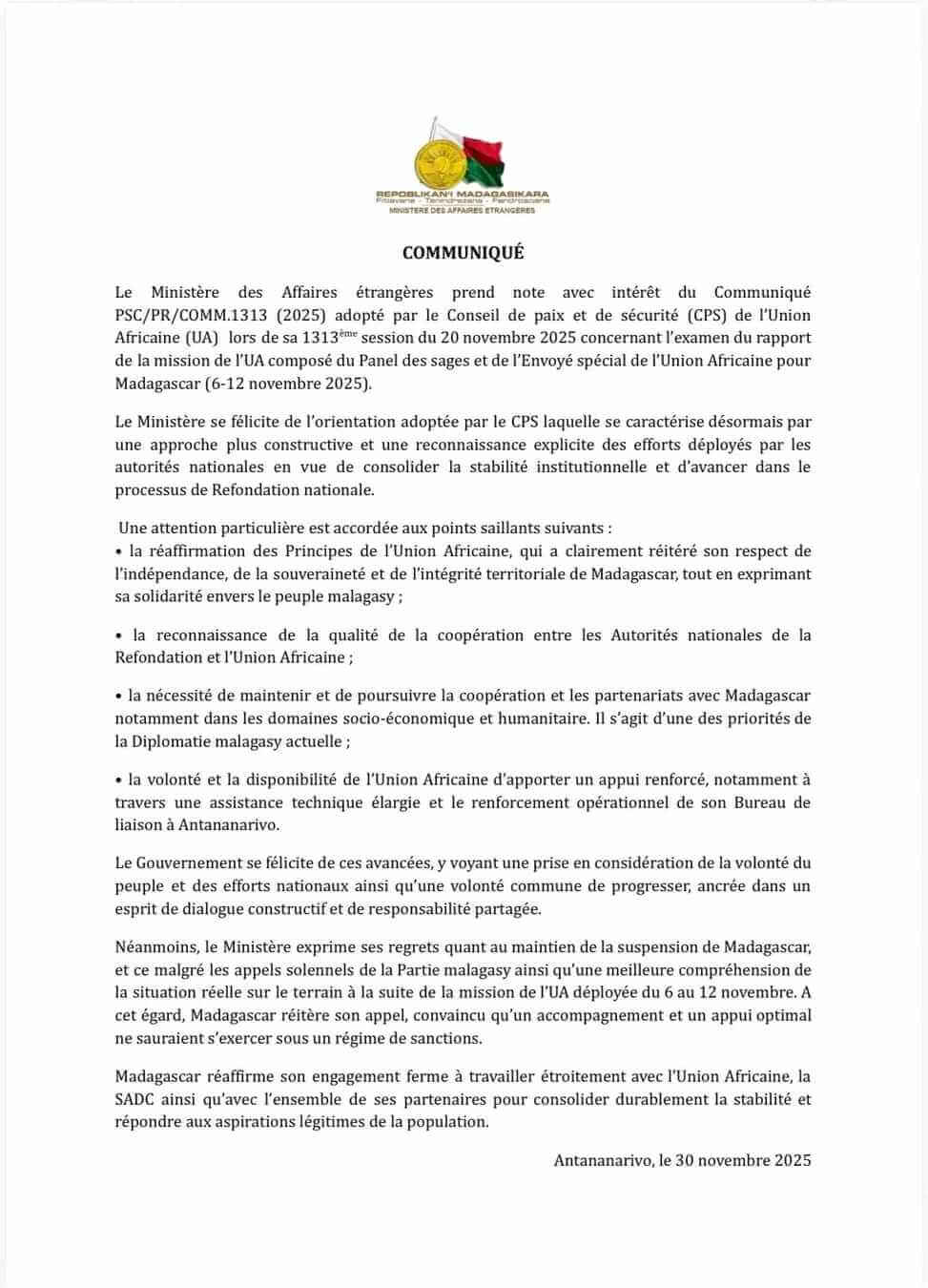La tension politique à Madagascar a pris une tournure internationale depuis que le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fermement condamné ce qu’il qualifie de changement anticonstitutionnel de gouvernement dans l’île de l’océan Indien. Par la voix de son porte-parole, Stéphane Dujarric, il a appelé les nouvelles autorités malgaches à un retour rapide à l’ordre constitutionnel et au respect de l’État de droit. Cette prise de position s’inscrit dans une série de réactions venant de la communauté internationale, alors que la situation politique du pays se dégrade dans un contexte de confusion institutionnelle, de contestation populaire et de sanctions annoncées par l’Union africaine.
Une condamnation sans équivoque de la communauté internationale
La déclaration du Secrétaire général des Nations unies est venue confirmer les inquiétudes grandissantes face à l’évolution de la crise politique malgache. Antonio Guterres a exprimé, par le biais de son porte-parole, une ferme désapprobation du processus qui a conduit à la prise du pouvoir par le colonel Michael Randrianirina. Selon l’ONU, cette transition de pouvoir ne respecte pas les principes fondamentaux de la Constitution malgache ni les normes démocratiques internationales.
Dans sa communication officielle, Stéphane Dujarric a rapporté que le Secrétaire général “condamne le changement anticonstitutionnel de gouvernement à Madagascar” et appelle “au retour à l’ordre constitutionnel et à l’État de droit”. Cette condamnation s’inscrit dans la continuité des positions prises par les Nations unies à l’égard des ruptures démocratiques observées sur le continent africain au cours des dernières années, que ce soit au Niger, au Mali, ou encore au Gabon.
Le porte-parole a également rappelé la décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, qui a suspendu immédiatement la participation de Madagascar à toutes les activités de l’organisation continentale, de ses organes et institutions, jusqu’au rétablissement de la légalité constitutionnelle. Cette suspension symbolise une mise à l’écart politique et diplomatique du pays, traduisant la désapprobation unanime des États membres de l’Union africaine face à cette prise de pouvoir jugée illégitime.
En parallèle, l’ONU a affirmé sa disponibilité à accompagner le peuple malgache dans la recherche de solutions durables. “Le Secrétaire général est prêt à soutenir les efforts nationaux visant à s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité dans le pays”, a précisé Dujarric, ajoutant que cet accompagnement se fera en étroite collaboration avec l’Union africaine, la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et d’autres partenaires internationaux.
Le colonel Randrianirina assume le pouvoir et rejette l’accusation de coup d’État
Face à cette vague de réprobation, le colonel Michael Randrianirina, nouvel homme fort de Madagascar, tente de se défendre. Celui qui doit prêter serment pour endosser la fonction de chef de l’État a déclaré ne pas avoir mené un coup d’État, mais plutôt répondu à une situation d’urgence institutionnelle. Selon lui, il n’y a eu “ni effusion de sang ni violences”, et son accession au pouvoir découle d’une décision de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), qui l’aurait invité à assurer l’intérim en l’absence du président de la République, du président du Sénat et du gouvernement.
Cette justification, toutefois, peine à convaincre la communauté internationale. Les observateurs notent que le contexte de crise politique et sociale à Madagascar ne permet pas de considérer cette transition comme un simple intérim constitutionnel. Les manifestations massives, les affrontements entre civils et forces de sécurité, ainsi que la vacance du pouvoir exécutif ont ouvert la voie à une recomposition institutionnelle non conforme aux procédures prévues par la Constitution.
Pour ses partisans, le colonel Randrianirina représente un espoir de stabilité et de retour à la souveraineté nationale, après des années de turbulences politiques marquées par la corruption, la pauvreté et la méfiance envers les élites. Ses détracteurs, en revanche, y voient une manœuvre militaire visant à s’imposer au pouvoir sans légitimité démocratique.
Le colonel a également réagi aux sanctions de l’Union africaine, les qualifiant de “réactions normales” auxquelles il s’attendait. “Nous sommes prêts à dialoguer avec nos partenaires régionaux et internationaux”, a-t-il indiqué, tout en affirmant que le peuple malgache devait “rester maître de son destin”.
Les Nations unies préoccupées par la répression et les violations des droits humains
L’implication de l’ONU dans la crise malgache ne date pas de la prise de pouvoir de Randrianirina. Depuis plusieurs semaines, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) s’était déjà inquiété de la dégradation de la situation sécuritaire et du recours excessif à la force contre les manifestants.
Le Haut-Commissaire Volker Türk avait déclaré que “les violences continues de la part de la gendarmerie contre les manifestants” constituaient une grave atteinte aux droits fondamentaux. Il avait appelé les forces de défense et de sécurité à “cesser tout recours à la force inutile” et à “respecter le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique”.
Selon les estimations du HCDH, au moins 22 personnes auraient perdu la vie lors des affrontements, tandis que plusieurs dizaines d’autres auraient été blessées. Le gouvernement sortant, de son côté, a contesté ces chiffres, parlant de 12 morts “au total”. Cette divergence dans le bilan témoigne du manque de transparence entourant la gestion de la crise et du climat d’opacité dans lequel évolue la scène politique malgache.
Au-delà des chiffres, c’est le signal politique envoyé qui inquiète les observateurs internationaux : Madagascar, souvent présenté comme un modèle démocratique fragile, semble replonger dans une instabilité chronique où les transitions de pouvoir s’opèrent en dehors des urnes. Cette situation compromet les efforts de développement et les réformes institutionnelles entreprises ces dernières années.
Une crise politique aux racines profondes
Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, il faut revenir sur les causes structurelles de l’instabilité politique à Madagascar. Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu de multiples changements de régime, souvent marqués par des interventions militaires, des contestations électorales et des périodes d’instabilité prolongées.
La crise de 2009, qui avait conduit à la chute du président Marc Ravalomanana et à l’arrivée au pouvoir d’Andry Rajoelina, reste encore dans toutes les mémoires. À l’époque, la communauté internationale, y compris l’Union africaine et les Nations unies, avait déjà condamné une prise de pouvoir jugée illégitime. Quinze ans plus tard, l’histoire semble se répéter, avec une même défiance envers les institutions démocratiques et une militarisation du pouvoir.
Le contexte socio-économique aggrave cette situation. Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses richesses naturelles considérables. La population, majoritairement rurale, subit de plein fouet les effets combinés du changement climatique, de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Cette fragilité alimente un cycle de crises politiques récurrentes, où chaque changement de régime s’accompagne d’une nouvelle vague de tensions.
Les organisations internationales, notamment l’ONU et la SADC, ont souvent tenté de promouvoir le dialogue national, mais les divisions internes et la méfiance entre acteurs politiques ont jusqu’ici empêché toute stabilisation durable.
Le difficile chemin vers un retour à l’ordre constitutionnel
La question qui se pose désormais est celle du retour à l’ordre constitutionnel, tel que demandé par l’ONU et l’Union africaine. Pour beaucoup d’observateurs, cette exigence ne pourra être satisfaite qu’à travers un processus politique inclusif, transparent et pacifique.
L’organisation d’élections libres et crédibles semble être la voie la plus légitime pour rétablir la confiance des citoyens. Cependant, cela suppose un cadre institutionnel stable, une autorité électorale indépendante et un environnement sécuritaire apaisé, conditions qui, à ce jour, ne sont pas réunies.
Le rôle de la Haute Cour constitutionnelle est également au centre du débat. En validant la prise de fonction du colonel Randrianirina, elle a alimenté la controverse sur sa propre impartialité. Certains juristes estiment que cette décision ouvre la voie à une instrumentalisation du droit au service d’intérêts politiques.
La communauté internationale, quant à elle, semble déterminée à maintenir la pression. L’Union africaine et la SADC envisagent de dépêcher une mission conjointe de médiation pour encourager un dialogue entre les différentes forces politiques malgaches. De son côté, l’ONU pourrait jouer un rôle de garant, en soutenant techniquement et financièrement la préparation d’élections si un consensus est trouvé.
Mais au-delà des mécanismes institutionnels, c’est la question de la confiance qui demeure centrale. Après des années de promesses non tenues et de transitions inachevées, une large partie de la population malgache exprime un profond désenchantement vis-à-vis de la classe politique. Pour espérer sortir de la crise, les nouvelles autorités devront convaincre non seulement les partenaires internationaux, mais surtout le peuple malgache lui-même.
Perspectives et enjeux pour l’avenir de Madagascar
Madagascar se trouve à un tournant décisif de son histoire politique contemporaine. La condamnation de l’ONU, les sanctions de l’Union africaine et les inquiétudes exprimées par la SADC placent le pays dans une situation d’isolement diplomatique inquiétante. Sans une issue rapide, les conséquences économiques et sociales risquent d’être désastreuses.
La suspension de la coopération internationale pourrait affecter de nombreux programmes de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire. De plus, les investisseurs étrangers, déjà frileux face à l’instabilité politique chronique, pourraient se détourner durablement du pays.
Sur le plan intérieur, le risque d’une escalade des tensions sociales demeure réel. Les manifestations se multiplient, et l’armée, désormais au cœur du pouvoir, pourrait être tentée de renforcer son emprise sur la vie politique. Cette perspective inquiète les défenseurs des droits humains, qui redoutent un durcissement du régime et une restriction accrue des libertés fondamentales.
Cependant, certains experts estiment que cette crise pourrait aussi représenter une opportunité. Si le colonel Randrianirina tient sa promesse d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et d’une transition apaisée, Madagascar pourrait renouer avec la stabilité et engager enfin les réformes structurelles nécessaires à son redressement.
La communauté internationale, pour sa part, semble prête à soutenir un tel processus, à condition qu’il repose sur des engagements concrets. Le peuple malgache, quant à lui, attend des actes forts et une véritable rupture avec les pratiques du passé.
Conclusion
La crise politique que traverse Madagascar illustre une fois de plus la fragilité des institutions démocratiques dans de nombreux États africains. En condamnant sans équivoque le changement anticonstitutionnel de gouvernement, l’ONU et ses partenaires rappellent l’importance du respect de la légalité, de la transparence et du dialogue politique.
Mais au-delà de la condamnation, le véritable enjeu reste celui de la reconstruction nationale. Pour retrouver sa place au sein de la communauté internationale, Madagascar devra renouer avec les principes de la démocratie et offrir à son peuple les garanties d’un État de droit effectif. Seule une transition pacifique, inclusive et légitime permettra au pays de tourner la page d’une nouvelle crise qui menace, une fois encore, son avenir démocratique.